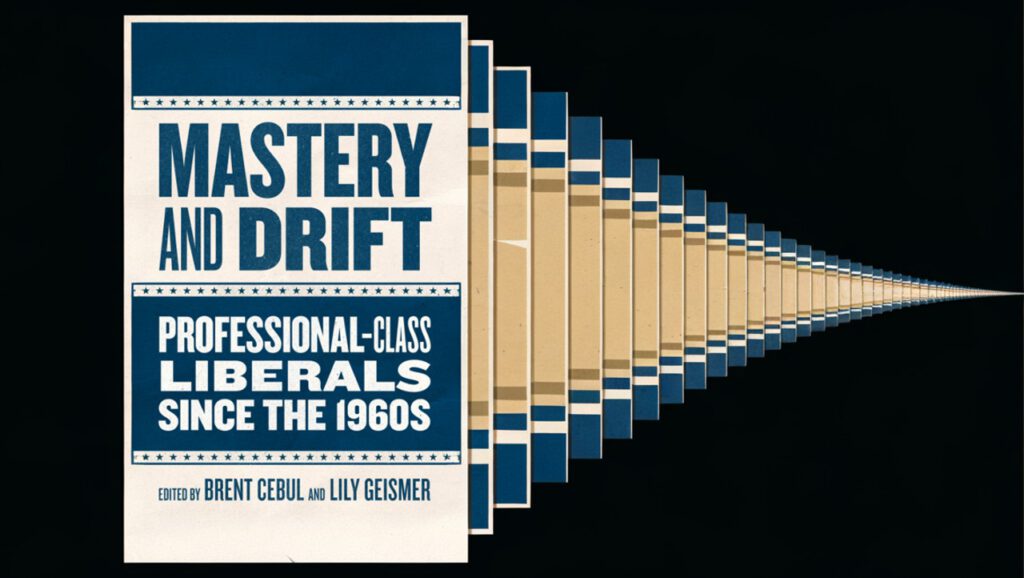Boston Review a récemment organisé une table ronde virtuelle avec les contributeurs d’un nouveau recueil d’essais, Mastery and Drift: Professional-Class Liberals since the 1960s, publié par University of Chicago Press. La vidéo complète de l’événement est disponible ci-dessous. La transcription qui suit correspond à la seconde partie de l’événement, avec une discussion modérée. Elle a été légèrement modifiée pour plus de clarté.
Le 18 février, dans sa première note de service en tant que président nouvellement élu du Comité national démocrate, Ken Martin a été franc dans son diagnostic. « Quand je parle de l’état du Parti démocrate, a-t-il écrit, je parle souvent de l’impact des perceptions, de ce que les électeurs voient, ressentent et perçoivent. Je crois que le signe avant-coureur de ce qui s’est passé le 5 novembre a été la récente démonstration que, pour la première fois dans l’histoire moderne, les Américains considèrent désormais les Républicains comme le parti de la classe ouvrière et les Démocrates comme le parti des élites. » Il a poursuivi : « Nous devons prendre au sérieux la tâche de réparer et de restaurer les perceptions de notre parti et de notre marque. Il est temps de rappeler aux travailleurs américains, et de leur montrer chaque jour, que le Parti démocrate a toujours été et sera toujours le parti des travailleurs.
Mais s’agit-il simplement d’une question de perceptions erronées ? Et le travail de réparation se limite-t-il à une simple réorientation de l’image de marque ? Dans Mastery and Drift, publié sous la direction des historiens Brent Cebul et Lily Geismer, les contributeurs suggèrent que la question est bien plus profonde. Selon leur lecture collective, le destin du Parti démocrate contemporain et du réseau plus large d’institutions dans lequel il est intégré est lié à l’émergence et à la transformation à plus long terme et plus fondamentale de ce qu’ils appellent le « libéralisme de classe professionnelle » depuis les années 1960.
Bien sûr, il n’y a rien de nouveau à parler de cette évolution. La droite américaine se vante depuis plusieurs décennies de l’influence démesurée des élites libérales. Et à la suite de la défaite de la campagne de Clinton en 2016, de nombreux intellectuels de gauche ont relancé une analyse des années 70 de la soi-disant « classe professionnelle-managériale » comme critique de l’establishment démocrate. Mastery and Drift (Maîtrise et dérive), dont le titre est une inversion délibérée de Drift and Mastery, le traité fondateur de Walter Lippmann sur le libéralisme américain publié en 1914, évite ces polémiques au profit d’une perspective historique plus longue et plus fouillée.
Au fil des quinze chapitres de l’ouvrage, les auteurs explorent des domaines aussi divers que la philanthropie, le conseil, les soins de santé, l’aide sociale, la race, l’immigration, l’économie et la politique étrangère. Dans tous ces domaines, ils affirment que l’on peut distinguer deux grandes tendances à partir des années 1960. La première est l’importance croissante d’une nouvelle génération de libéraux de classe professionnelle : avocats, économistes, experts politiques, dirigeants d’organisations à but non lucratif, sondeurs, consultants politiques, journalistes, etc., motivés notamment par l’expansion majeure de l’enseignement supérieur et professionnel au cours de cette période. Deuxièmement, l’émergence d’une forme particulière de gouvernance libérale : le fétichisme de l’expertise et du pragmatisme, une sorte de techno-optimisme et de foi inébranlable dans les politiques fondées sur des données, ou, comme le disent les rédacteurs, une « profonde satisfaction à trouver des solutions politiques juridiques et techniques sophistiquées et, pour les citoyens, difficiles à comprendre ». Il s’agit d’un imaginaire de gouvernance nettement technocratique, qui convenait à la sensibilité et peut-être même aux intérêts de cette nouvelle classe professionnelle. Mais c’est aussi une conception qui rompt nettement avec les réformes radicales et parfois structurelles des premières générations de libéralisme américain, et qui semble de plus en plus épuisée et inadéquate face aux crises qui se chevauchent et nous engloutissent aujourd’hui.
Au sein de la profession historique américaine, une grande attention a été accordée au cours des dernières décennies à la montée du conservatisme américain : ses racines distinctives et son succès singulier, en particulier depuis les années 1980. Et il est certain que les priorités politiques de l’administration actuelle, malgré toute sa rhétorique populiste et ses attaques virulentes contre l’État administratif, suggèrent que l’histoire reste d’une importance vitale pour comprendre notre présent. Mais comme le soutiennent les auteurs de cet ouvrage, le revers de cette montée du conservatisme est le déracinement civique du libéralisme américain et sa circonscription à une large, bien que démographiquement étroite, tranche de professionnels d’élite. De ce point de vue, un énième exercice de rebranding du Parti démocrate pourrait ne pas être pleinement adapté à la tâche. Les historiens n’aiment pas faire de prédictions, mais à tout le moins, l’impact des bouleversements décrits dans l’ouvrage définira certainement un terrain de lutte dans un avenir prévisible.
—Simon Torracinta, rédacteur en chef adjoint
Simon Torracinta : L’introduction et de nombreuses contributions de l’ouvrage comparent le libéralisme de la classe professionnelle post-années 1960 aux formes antérieures de libéralisme : les idées afro-américaines de la fin du XIXe siècle sur l’élévation raciale, le libéralisme de l’ère progressiste, le libéralisme des entreprises, le libéralisme de la guerre froide du milieu du siècle. Qu’est-ce qui distingue ce moment post-années 1960 ? Qu’est-ce qui est nouveau par rapport à ce qui est ancien ?
Nicole Hemmer : Récemment, les historiens se sont attachés à mettre en évidence les liens entre ce qui s’est passé dans les années 1950 et 1960 et ce qui s’est passé par la suite. Keeanga-Yamahtta Taylor, par exemple, explique comment la formule du logement néolibéral a été intégrée à la Grande Société, une époque que nous considérons comme le moment triomphant du libéralisme.
Ce que j’ai constaté, à la fois dans ce livre et dans mon propre travail, c’est que le libéralisme qui a suivi les années 1960 est beaucoup plus restreint : ses visions sont plus limitées, ses idées sur la capacité de l’État sont plus restreintes. Et cela ne conduit pas nécessairement au néolibéralisme, mais le libéralisme qui subsiste me semble très limité en termes d’objectifs et de vision.
Brent Cebul : Je pense que c’est tout à fait exact que les visions sont plus petites. Mais il est également vrai que l’État est tellement plus grand : la population du pays est tellement plus importante ; sur le plan spatial, l’éventail des projets que l’État mène est tellement plus large. Et cela nécessite un certain degré d’expertise. C’était également le cas au cours des décennies passées – nous pouvons par exemple citer le rôle des avocats dans le « Brain Trust » de Roosevelt – mais ces experts travaillaient au début de la croissance de l’État. Et je pense que l’une des plus grandes contraintes auxquelles sont confrontés les libéraux de la classe professionnelle après les années 1960 est la nature même de l’État : la dépendance au sentier, les agences, tout cela.
Il est important de prendre au pied de la lettre la complexité de l’appareil étatique et la conception que ces libéraux ont d’eux-mêmes, à savoir qu’ils font le bien. Mais la manière dont cette intention est exprimée est également très importante. Dans de nombreux cas, elle est exprimée par l’économie, par le droit, par les types de connaissances incrémentales, hautement techniques et très spécifiques qui sont nécessaires pour accomplir une grande partie de ce travail étatique. Donc, à un certain niveau, je pense que ce qui manque, c’est une vision morale qui puisse galvaniser et appeler à une réorganisation de l’État en termes macroéconomiques et pas seulement microéconomiques.
Lily Geismer : Il est également nécessaire de reconstruire la coalition libérale-gauche. Il y a de grands chapitres dans le livre de Julilly Kohler-Hausmann et Timothy Shenk sur le rôle des sondeurs et autres experts en matière de vote dans la formation de l’électorat : décider qui compte et qui ne compte pas en termes de participation à la coalition. Ce changement a énormément façonné le libéralisme après les années 1960, et il contribue également, sur le plan électoral et politique, à la nouvelle orientation de la classe professionnelle. C’est aussi une période où l’on voit le libéralisme se dissocier réellement des organisations de gauche telles que les syndicats et des aspirations qui ont défini d’autres moments du projet libéral, en particulier le New Deal. Il y a un manque de véritable préoccupation pour la signification du travail organisé, par exemple.
Dylan Gottlieb : Nous pourrions appeler cette nouvelle orientation le libéralisme post-nouvelle gauche. Il est empreint de scepticisme à l’égard de l’État et de son pouvoir écrasant, qui s’adresse également aux syndicats et aux grandes entreprises – Nader en est un parfait exemple. C’est un rejet des grandes institutions totalisantes et dominatrices. C’est très de la Nouvelle Gauche, mais dépouillé de la politique radicale de la Nouvelle Gauche. C’est une orientation qui peut s’exprimer culturellement – vers des institutions aliénantes et des emplois abrutissants, ou vers un gouvernement oppressif et inefficace.
Et qui est son héros ? C’est un nouveau type de protagoniste : un technocrate capable de contourner des institutions sclérosées et de produire le changement, pour déclarer sur le terrain que le New Deal est terminé. Ces personnalités utilisent certains des outils de l’État pour œuvrer à des fins limitées, sans nécessairement viser les horizons utopiques de la Nouvelle Gauche. Mais même s’ils ont abandonné certains de leurs objectifs, ils ont conservé cette teinte d’anti-étatisme et d’anti-institutionnalisme qui peut se manifester sous la forme d’un néolibéralisme de droite pour certains ou d’un néolibéralisme libéral pour d’autres.
Simon Torracinta : Un thème commun à de nombreuses contributions est le scepticisme des libéraux à l’égard de l’exercice sans entrave du pouvoir de l’État, ou la prudence quant à l’utilisation de l’État. D’où vient ce scepticisme ? Quelles sont ses racines ? Et comment cela façonne-t-il cette gouvernance libérale particulière que vous avez décrite jusqu’à présent ?
Danielle Wiggins : Dans mon chapitre, j’évoque son expression particulière dans la politique noire. J’utilise le terme « scepticisme à l’égard de l’État » pour décrire ce que je considère comme une impulsion qui souligne cette politique d’auto-assistance et ce type de préférence durable pour la protection sociale du secteur privé et la politique noire. Les personnes que je décris, les libéraux noirs professionnels, ne sont pas complètement antistatiques. Comparés aux nationalistes et aux conservateurs noirs, qui sont des antiétatistes, les libéraux noirs de la classe professionnelle qui travaillent au sein du gouvernement et des organisations de défense des droits civiques exigent constamment une intervention agressive de l’État dans les structures de l’inégalité raciale. Mais en même temps, ils ont une conscience très pragmatique des méfaits de l’État libéral : son histoire d’abandon, ses formes de violence manifestes et ses interventions constantes pour maintenir le capitalisme ségrégationniste.
Ainsi, les militants noirs de tous bords politiques, même ceux qui travaillent au sein de l’appareil d’État à partir des années 1960, reconnaissent que les Noirs ne peuvent pas dépendre de l’État parce que c’est le même État libéral qui a consolidé les droits politiques et économiques des Blancs par l’exclusion et l’exploitation des Noirs, non seulement au détriment des Noirs, mais par leur intermédiaire. Ainsi, contrairement à d’autres formes de scepticisme vis-à-vis de l’État que l’on observe chez d’autres libéraux de la classe professionnelle, le scepticisme des libéraux noirs de la classe professionnelle à l’égard de l’État ne repose pas sur une critique des excès de la Grande Société ou des inefficacités du libéralisme du milieu du siècle, mais plutôt sur une critique des limites et des violences du libéralisme.
Nicole Hemmer : J’ajouterais qu’avant d’arriver aux années Obama, il y a eu trente à quarante ans de gouvernance conservatrice depuis les années 1970. Et je pense que les libéraux, s’ils n’ont pas entièrement absorbé toutes les critiques des conservateurs à l’égard du gouvernement, en ont certainement absorbé certaines. Il y avait aussi un certain scepticisme quant à la capacité des libéraux à vendre un gouvernement fort aux Américains. Cela a conduit à des politiques telles que l’idée de « coups de pouce » de l’administration Obama, l’idée que l’on peut créer des préférences pour les gens, les pousser dans une certaine direction, sans intervention directe du gouvernement. Le gouvernement va jouer un rôle paternaliste en vous orientant vers ce qu’il pense être bon pour vous, mais d’une manière discrète, pour que l’on ne voie pas que le gouvernement agit. Et bien sûr, c’était très bon marché, car ils ne voulaient pas dépenser d’argent pour quoi que ce soit.
Brent Cebul : Un point qui me semble également très important d’un point de vue historique, et qui, je pense, est également un sujet de réflexion pour les libéraux après les années 1970 dans le cadre du projet de mémoire politique, est la mesure dans laquelle le New Deal et l’État du milieu du siècle se sont appuyés sur la structuration des marchés et non sur la fourniture publique de biens publics (à l’exception de mesures telles que les taux marginaux d’imposition confiscatoires, la sécurité sociale et certaines dispositions réglementaires). Le fonctionnement de l’État du New Deal reposait en grande partie sur la sécurisation des marchés, en passant par des intermédiaires privés. L’État keynésien militaire de la guerre froide en était l’exemple classique. Une partie de la difficulté que rencontrent les libéraux et les conservateurs depuis les années 1960 – et c’est, franchement, ce à quoi Elon Musk et Donald Trump sont confrontés en ce moment – est que lorsque nous parlons de limiter le poids de l’État, ce que nous limitons en réalité, ce sont les dépenses qui passent par des intermédiaires privés ou infranationaux.
Cela crée une sorte de climat politique de boxe fantôme où l’on peut voir sur la page que le gouvernement dépense beaucoup d’argent – qu’il y a beaucoup d’agents de subvention, d’entrepreneurs et de superviseurs, comme le montre le chapitre de Stephen Macekura – mais que l’État lui-même est à la fois là et n’est pas là. Cela crée une sorte de rhétorique en spirale, antistatiste et hyper-privatisée, alors qu’en fait, c’est souvent ainsi que l’État libéral a fonctionné historiquement. Et cela rend également très difficile pour les libéraux de mettre en avant des moments d’action publique robuste dans le passé.
J’ai écrit sur les appels assez spectaculaires de Bill Clinton en faveur d’une politique industrielle au début des années 1990. Et le meilleur qu’il ait pu trouver comme précédent à ce qu’il essayait de faire était le réseau routier. Je pense que c’est un autre élément de cette question : il existe une continuité plus profonde qui a rendu l’imagination politique beaucoup plus étroite qu’elle ne l’aurait été autrement.
Lily Geismer : Sans vouloir tout rendre hyper-présidentialiste, je pense que nous devons tenir compte du fait que les libéraux ont contribué à la version moderne du scepticisme de l’État pour un certain nombre de raisons différentes et de différentes manières. Nous ne devons pas simplement blâmer Musk et Trump pour avoir soudainement fait cela. C’est un récit continu, et une partie intégrante de la version particulière du libéralisme de classe professionnelle qui a été très dominante dans les années 1990 jusqu’à l’administration Obama : un libéralisme qui croyait en l’existence simultanée d’approches techniquement avisées du gouvernement d’une part et d’approches de marché pour rendre le gouvernement plus efficace d’autre part. Il y a là une dualité intéressante, qui s’inscrit davantage dans une continuité que dans une rupture nette avec ce qui se passe actuellement.
Simon Torracinta : Je vais répondre à quelques questions du public. Tout d’abord, le libéralisme de classe professionnelle est-il nécessairement une forme de néolibéralisme, compte tenu de l’évolution de l’économie capitaliste mondiale après les années 1970 (Bretton Woods, libre-échange, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, etc.) ? Nous pourrions élargir la question en demandant de manière générale : qu’est-ce qui, dans ce volume, vous semble parler de l’histoire du néolibéralisme ou s’en différencier ?
Brent Cebul : Je ne pense pas que le libéralisme de la classe professionnelle soit nécessairement une composante du néolibéralisme. Nous essayons de l’expliquer clairement dans l’introduction du livre. Je pense que dans tout appareil gouvernemental aussi complexe et ambitieux que l’État américain continue de l’être, vous aurez besoin d’experts bien formés et animés d’un esprit civique. Mais je pense – et vous voyez ces parallèles en Europe occidentale et dans d’autres pays développés – qu’à mesure que les rangs de ces experts formés professionnellement se sont étoffés, on a assisté à un appauvrissement simultané de l’imagination politique chez les libéraux.
Cela fait partie intégrante de la composition de classe des institutions dont ils font partie. Cela ne signifie pas nécessairement que cela doit faire partie d’un projet néolibéral, mais cela signifie que les institutions dont ils font partie doivent être subordonnées à une vision morale et sociopolitique plus large. Je ne pense donc pas que nous allons simplement nous débarrasser un jour des libéraux de la classe professionnelle (bien que Musk et Trump essaient certainement de le faire). J’espère plutôt que nous pourrons associer leur maîtrise à une vision sociale beaucoup plus solide.
Dylan Gottlieb : Je pense aussi que la santé relative des institutions dans une économie politique en mutation est essentielle. Le déclin des syndicats en tant qu’épine dorsale institutionnelle du parti démocrate est essentiel ici. Le modèle fordiste d’employés syndiqués qui étaient psychiquement alignés sur le libéralisme autant qu’ils étaient profondément ancrés dans les organisations qui les mobilisaient et créaient un projet commun est en déclin. C’est un aspect de la transformation postindustrielle que nous suivons : peut-être pas toujours explicitement, mais il est en arrière-plan.
Et à sa place, il y a de nouvelles formes d’accumulation flexible – on pourrait dire financiarisation ou précarisation. La philanthropie joue un rôle croissant dans la vie libérale (nous avons un chapitre dans le livre à ce sujet). La finance prend le dessus. Les journalistes sur lesquels j’écris dans mon chapitre travaillent dans ces lieux de travail flexibles où personne n’est syndiqué. Personne n’a d’assurance maladie. C’est très précaire. Et nous pouvons donc suivre le déclin des institutions qui sous-tendaient la coalition libérale comme une sorte d’histoire parallèle au néolibéralisme – c’est certainement lié, mais ce n’est pas la totalité de cette transformation.
Brent Cebul : Et tout cela fait partie d’un projet plus large de désocialisation et de fragmentation des individus. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il est impossible de syndiquer un lieu de travail de cols blancs. Mais avec les nouvelles conditions de travail (hotellerie, WeWork, espaces flexibles), cela devient de plus en plus difficile. Ce sont des questions de capital, d’économie politique, de gestion.
Nicole Hemmer : Et les syndicats eux-mêmes sont soumis à ces mêmes forces. Le SEIU, qui était un syndicat largement dirigé par des Noirs, des Latinos et des femmes au début de la présidence d’Obama, est repris par des organisateurs blancs de classe professionnelle, ce qui change la teneur du syndicat, son fonctionnement, son organisation et les liens qui le sous-tendent. Il y a une certaine syndicalisation, mais elle est également soumise aux forces de la professionnalisation qui brisent certains des liens communautaires qui étaient si importants pour en faire un syndicat fort au départ.
Simon Torracinta : Nous avons une question anonyme, qui exprime probablement ce que beaucoup de personnes dans le public pensent : alors que Trump et Musk déconstruisent l’État administratif, le silence moral et politique des libéraux du Parti démocrate est assourdissant. Voyez-vous des ressources que le libéralisme contemporain peut apporter à la crise ? Et je sais que les historiens n’aiment pas prédire l’avenir, mais je pourrais ajouter à cela et demander comment cette histoire façonne les contraintes et les possibilités du libéralisme alors qu’il réagit – ou peut-être ne réagit pas – à ce moment ?
Lily Geismer : Ma réponse est un peu hors sujet, mais j’espère qu’elle vous aidera à comprendre. Lorsque Kamala Harris a annoncé que Tim Walz serait son colistier, Brent m’a envoyé un SMS : « Notre livre est-il condamné ? Qu’est-ce que cela signifie ? » En fin de compte, cela n’a fait que confirmer le point de vue du livre, car Harris et son équipe n’ont pas vraiment utilisé les compétences populistes de Walz dans la campagne. Pour moi, la campagne de Harris incarne parfaitement tant de dimensions de notre volume et de ce que nous avons décrit : la manière dont ces idées façonnent les démocrates et les libéraux, tant sur le plan politique qu’en termes d’approche politique.
J’espère, d’une certaine manière, que la défaite électorale servira de leçon, d’une certaine manière : d’une part, pour réfléchir aux limites de cette approche, mais en même temps, pour réfléchir à ce que l’État est et peut faire. Comment continuer à avoir certaines formes de scepticisme envers l’État tout en réfléchissant à la longue tradition de gouvernance du Parti démocrate et du libéralisme ? J’espère que ce livre sera un premier pas vers l’ouverture de ce type de conversation.
Brent Cebul : En réfléchissant à l’évolution des années 1960 à nos jours, je pense – et c’est quelque chose que Gabe Winant expose dans sa conclusion – que la façon dont les historiens étudient la politique, mais aussi la façon dont les libéraux ont pensé la politique à partir des années 1970, étaient toutes deux très centrées sur l’État. Plutôt que d’organiser des manifestations de masse pour aller protester quelque part et peut-être se faire arrêter, on organisait, comme le montre le chapitre de Sarah Milov et Reuel Schiller, un cabinet d’avocats d’intérêt public et on poursuivait les salauds, ou on se faisait embaucher par l’agence de régulation. Il y avait une idée très intérioriste du changement politique qui faisait de l’État le principal acteur, tant dans la façon dont les universitaires pensaient le changement politique que dans celle de nombreux libéraux. Voter suffisait : tant que vous aviez les bonnes personnes, elles concevaient la bonne politique et amélioraient les choses correctement.
Je suis donc vraiment perplexe par le fait qu’en ce moment, Hakeem Jeffries et d’autres disent en gros : « Nous avons les mains liées ». Où est leur maîtrise technique des règles du Congrès et du Sénat ? Où est la connaissance complexe de la manière dont nous pouvons utiliser les points de blocage institutionnels et l’effet de levier pour ralentir les choses ? Où est-elle ? Même un mode de lutte interne semble absent pour le moment. Cela, pour moi, montre la vacuité politique et morale totale de la situation. Nous allons devoir le faire nous-mêmes.
Nicole Hemmer : Je suis également frappée par le fait que le Parti démocrate contemporain est enfermé dans la logique d’une époque politique révolue à laquelle il ne peut échapper. Ses appels à travailler avec l’administration républicaine rappellent l’époque où le bipartisme était la meilleure chose à faire. Cet institutionnalisme a empêché le Parti démocrate d’agir avec plus d’audace au cours des quatre dernières années. Il semble que l’ancienne version de la politique libérale soit en train de menotter le Parti démocrate actuel.
Pour aller de l’avant, non seulement ils vont devoir se défaire de ces engagements envers le bipartisme et l’institutionnalisme, mais à mesure que l’État administratif sera déconstruit, ils vont également devoir devenir visionnaires. Il ne suffira pas de réembaucher un tas de gens, il faudra vendre une nouvelle vision. Si la capacité de l’État a été fondamentalement détruite, il ne suffit pas d’essayer de redonner vie aux institutions créées dans les années 1930. Il va falloir repartir de zéro.
Simon Torracinta : Une dernière question. À une époque de l’histoire, faire partie de la classe professionnelle instruite était une aspiration américaine partagée par beaucoup. Selon vous, quel a été le point de basculement qui a transformé cette aspiration en une source de vitriol et en une insulte à la limite de la diffamation parmi les Américains de la classe ouvrière ? En d’autres termes, pourquoi est-il devenu si mal vu d’être un libéral de la classe professionnelle ? Et pourquoi des majorités politiques se sont-elles formées pour les rejeter ?
Nicole Hemmer : D’une part, il y a eu une campagne de soixante-quinze ans contre l’enseignement supérieur menée par la droite, qui a été efficace parce qu’elle a été amplifiée par les politiciens et par leurs propres médias. C’est une grande partie de l’explication.
Brent Cebul : Je pense qu’il est important de noter que ce type d’anti-intellectualisme est profondément américain. Richard Hofstadter a écrit un livre entier à ce sujet en 1963. Mais l’aspect institutionnel, à savoir la hausse des coûts de l’enseignement supérieur, est également très important. Les libéraux du milieu du siècle sous l’administration Johnson ont décidé qu’au lieu de subventionner directement et publiquement les frais de scolarité, ils allaient structurer un marché de la dette pour que les gens puissent emprunter pour aller à l’université. Ce n’est donc pas simplement que les gens sont contre l’enseignement supérieur ; c’est que la barre de l’enseignement supérieur est devenue de plus en plus élevée alors que l’économie ne récompense plus tous les types d’emplois que vous pourriez vouloir poursuivre avec votre diplôme. Il y a là une histoire structurelle : les personnes qui dirigent ces universités, les personnes qui ont créé ces marchés de la dette, étaient vraiment déconnectées de la façon dont les gens percevaient et vivaient ces structures.
Lily Geismer : Je pense aussi que cette version particulière de libéraux de la classe professionnelle a une véritable foi en son propre projet. Ce sont tous des gens qui en ont bénéficié à divers titres, donc c’est ce que vous reproduisez, et cela devient vraiment problématique. J’ai étudié ailleurs l’obsession des démocrates et des libéraux pour la reconversion professionnelle : l’idée que l’on peut restructurer l’ensemble de l’économie en délocalisant des emplois et que les gens vont comme par magie aller dans un collège communautaire et accéder soudainement à de nouveaux emplois.
Dylan Gottlieb : Ils apprendront à coder.
Lily Geismer : Exactement, tout le monde va devenir codeur. Cela aurait pu être un peu convaincant dans les années 1990, mais à l’heure actuelle, ce n’est tout simplement pas un message réaliste.
Dylan Gottlieb : Je pense qu’il y a une part de vérité dans certaines critiques de la droite, même si elles sont souvent faites avec une foi aveugle et sont chargées d’un bagage anti-féministe, anti-immigrant et raciste. Il y a, en effet, une nouvelle classe qui émerge dans le sillage de la transformation postindustrielle, et ils sont un peu mielleux quant à leur supériorité autoproclamée. Ils sont gagnants dans la nouvelle économie et ils sont ravis de diffuser ce fait à travers leur savoir-faire culturel, leur distinction, leurs habitudes culturelles, ce qu’ils achètent, ce qu’ils mangent, où ils vivent, comment leurs maisons sont aménagées. Et cela a un poids culturel profond et un capital qu’ils peuvent accumuler.
Pendant ce temps, ces marqueurs viennent remplacer l’inégalité plus large dont bénéficient les professionnels. Ils se trouvent au sommet d’une pyramide économique qui est financiarisée, qui leur est favorable et qui n’est pas aussi ouverte aux nouveaux arrivants qu’ils pourraient le croire. Les signes extérieurs de ce monde sont ensuite affichés et diffusés par le biais d’expressions culturelles – cinéma, télévision, médias sociaux, journalisme – qui deviennent la cible de la dérision de la part de ceux qui sont laissés de côté. On peut se demander s’il s’agit d’un phénomène freudien complexe, où les personnes moins fortunées convoitent et renient simultanément ces ornements de la classe professionnelle. Mais il se passe quelque chose, n’est-ce pas ? L’antilibéralisme de la réaction, par exemple, d’un col bleu blanc conservateur face aux manifestations de suffisance narcissique : on peut en plaisanter, mais je pense que c’est réel. Parce que les libéraux de la classe professionnelle sont très attachés à leurs diplômes, et qu’ils ont travaillé très dur pour s’assurer une maison en pierre dans un quartier embourgeoisé, et qu’ils font leurs courses dans les magasins locaux et s’en félicitent.
Ces choses ne sont pas nécessairement nuisibles en elles-mêmes sur le plan politique. Mais ces libéraux de la classe professionnelle se sont exposés aux critiques de personnes qui expriment leurs griefs concernant l’inégalité et la diversification de l’élite par un langage qui vise davantage à attaquer le libéralisme et ses piétés qu’à critiquer le conservatisme. Se moquer du politiquement correct devient une industrie artisanale, et cela a de profondes implications politiques pour ceux qui trouvent du pouvoir ou prennent plaisir dans ce discours transgressif. Et cet esprit devient un drapeau sous lequel on peut défiler sur le Capitole.
Simon Torracinta est maître de conférences en histoire des sciences à Harvard et rédacteur en chef adjoint de la Boston Review. Ses écrits ont également été publiés dans n+1 et The New Inquiry.
Brent Cebul est professeur agrégé d’histoire à l’université de Pennsylvanie et auteur de Illusions of Progress: Business, Poverty, and Liberalism in the American Century.
Lily Geismer est professeure d’histoire au Claremont McKenna College. Son dernier livre s’intitule Left Behind: The Democrats’ Failed Attempt to Solve Inequality.
Dylan Gottlieb est professeur adjoint d’histoire à l’université Bentley.
Nicole Hemmer est professeure agrégée d’histoire à l’université Vanderbilt et a cofondé la rubrique Made by History du Washington Post. Son dernier livre s’intitule Partisans: The Conservative Revolutionaries Who Remade American Politics in the 1990s.
Danielle Wiggins est professeure adjointe d’histoire à Caltech.
10 mars 2025, compte rendu du débat organisé à l’occasion de la sortie du livre “Mastery and Drifts : Professionnal-Class Liberals since the 1960s”, Brent Cebul et Lily Geismer, Chicago Press University, traduction Pour Press. Le terme “libéral” aux USA désigne la gauche non marxiste.