Depuis quelque temps, le syndicalisme étatsunien est en pleine effervescence. Il est plein d’énergie et d’optimisme. Après des décennies de revers, de défaites et de déceptions, le monde du travail aux États-Unis semble avoir emprunté une autre voie, modifiant le registre idéologique et les pratiques organisationnelles de l’ancien syndicalisme d’entreprise, appelé business unionism et très accommodant avec les directions d’entreprise, pour passer à l’offensive. Cela se fait sur la base d’une réorientation tactique et stratégique qui, depuis quelques années, est au centre de l’action syndicale, sous la bannière d’un syndicalisme de mobilisation sociale (movement unionism), bien plus combatif en organisé par en-bas, dont nous avons nous déjà eu des échos, par exemple dans le domaine de l’organizing et du renouveau syndical, comme celui initiée par la fédération SEIU [1] qui a formé d’abord la coalition Change to win, qui s’est réorganisé ensuite comme Strategic Organizing Centre regroupant de quatre fédérations syndicales de secteur[2].
.
UNE NOUVELLE PHASE
L’année 2023 marque un tournant avec plus d’un demi-million de travailleurs américains qui se sont mis en grève, obtenant des augmentations de salaire de 6 à 7% en moyenne. Les récentes victoires retentissantes contre les trois géants de l’automobile (Ford, General Motors et Stellantis) – suivi par la reconnaissance syndicale dans l’usine de Volkswagen à Chattanooga, Tennessee et qui se prolongera très probablement par des percées équivalentes chez Daimler-Mercedes et Toyota, reflète la combativité croissantes des travailleurs des états du Sud qui sont restés pendant longtemps marqués par une culture antisyndicale et des divisions raciales. Citons aussi la paralysie imposée par les acteurs et les scénaristes, jusqu’à la victoire, dans le monde d’Hollywood contre l’application de l’intelligence artificielle ; la syndicalisation de 10 000 salariés employés dans les 400 cafés Starbucks ; la reconnaissance syndicale obtenue par les travailleurs d’Amazon de Staten Island (New York) ainsi que celle des chauffeurs d’UPS dans plusieurs états ; l’augmentation de 25 % des salaires dans la restauration rapide en Californie ; les nombreuses victoires parmi les enseignants et le personnel de soins, sont la démonstration de ce changement d’époque en faveur du monde du travail.
Ce retour en force du syndicalisme trouve son origine dans l’action soutenue menée par le réseau de militants syndicaux initié par le journal mensuel de Labor Notes. Né en 1979, à l’initiative d’un groupe de militants syndicaux et de la gauche radicale socialiste, Labor Notes a poursuivi inlassablement pendant plus de quatre décennies un travail d’éducation populaire, de formation aux « bonnes pratiques militantes », tout en jouant un rôle informatif de premier plan en faisant circuler les comptes-rendus des luttes et des mobilisations, tant au niveau de secteurs que des entreprises, l’action communautaire autour des workers centres, et publiant plusieurs manuels sur le bon syndicaliste « trublion » (si l’on veut traduire troublemaker) et sur les secrets de l’organisateur – disons du militant syndical – qui sait gagner des adhésions et mobiliser collectivement ses collègues de travail, par-delà les clivages raciaux, de genre, de qualification, de statut ou générationnels.
Au cours de la conférence de Labor Notes, ce travail d’éducatif a reçu l’appui manifeste de l’actuel président du puissant syndicat de l’automobile (United Automobile Workers), Shawn Fain, pour qui le Troublemakers Handbook n’est rien de moins que sa « bible » syndicale, qui l’a inspiré dans le combat interne pour le renouveau radical avec lequel il a d’abord gravi les échelons de l’organisation, et qui l’a ensuite guidé – au cours des deux dernières années – vers des objectifs qui auraient semblé impensables ou irréalistes jusqu’alors.
LE RÔLE DE LABOR NOTES
Mais Labor Notes, c’est aussi une conférence organisée tous les deux ans, en croissance continue et exponentielle d’une édition à l’autre, qui, du 19 au 21 avril dernier, a vu converger dans un des plus grands hôtels de Chicago jusqu’à 4 700 délégués de base et responsables syndicaux de tous les Etats-Unis, mais aussi de divers pays, dont certains d’Italie – de la Fédération des métallurgistes (FIOM) et de la Fondation Giuseppe di Vittorio [3]– pour discuter et échanger des expériences au cours de plus de 300 ateliers à propos d’une grande variété de thèmes syndicaux et de l’importance cruciale de réinvestir les relations collectives de travail (industrial relations) de manière combative afin d’obtenir à nouveau des victoires. Cette conférence ne fut ni un congrès ni une sorte de forum mais forme un cadre d’échanges et de formation extrêmement intéressant, en raison de son caractère pragmatique et opérationnel, horizontal et décentralisé, visant à partager au maximum les expériences et à comparer les pratiques de lutte menées, pour la plupart, dans des unités de production fragmentées, mais en concentrant tous les efforts à la recherche des pratiques les plus efficaces et les plus fructueuses.
La figure de ce syndicalisme d’en-bas – grassroots et rank-and-file, selon un lexique anglo-saxon que nous ne connaissons pas – réside dans le lien qui peut être construit entre l’organisation d’une part – en élargissant sa capacité à représenter les non-organisés – et le conflit assumé et la négociation collective d’autre part. L’objectif étant d’obtenir des d’avancées sociales concrètes, que ce soit en matière de salaires ou de conditions générales de travail et de vie.
EXPÉRIENCES CONCRÈTES
La conférence fut un véritable moment de foisonnement, avec des exposés de militants de base, des chercheurs, des responsables de structure et surtout beaucoup d’expériences concrètes à raconter et à transmettre, à « réseauter » pour établir des contacts. Avec seulement quelques séances plénières, au début et à la fin, et surtout un programme très dense qui s’est prolongé jusque tard dans la soirée, avec des moments de détente et de divertissement, musical ou théâtral, le tout dans une atmosphère de grande solidarité, d’effervescence qui fut rendue possible par l’extraordinaire présence de jeunes travailleurs. La génération qui s’engage dans le combat syndical est composé par les filles et les fils de cette « autre Amérique », coloré et combative, pleine d’optimisme et qui est aujourd’hui puissamment revenue sur la scène politique et médiatique internationale, grâce aux mobilisations pro-palestiniennes sur les campus universitaires. Le keffieh était à Chicago un symbole dominant, porté sur les T-shirts et sweatshirts de leur organisation, qu’ils soient du syndicat de l’automobile, les chauffeurs de poids lourds (les biens connus Teamsters), les enseignants ou personnel infirmier, hôtesses de l’air, employés d’Amazon, d’UPS ou encore de Starbucks.
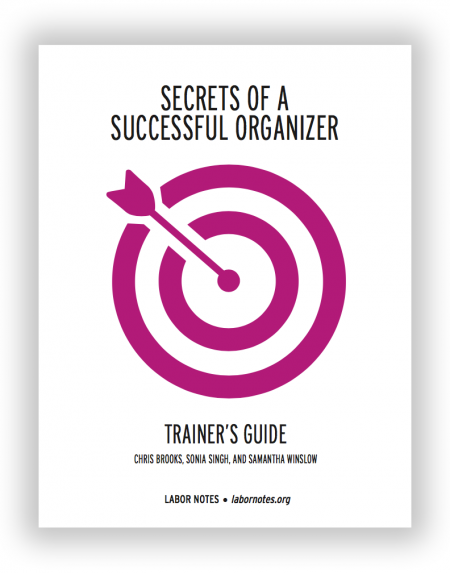
UN GRAND ABSENT : LA POLITIQUE
Ce qui était frappant, en revanche, c’était l’absence presque totale d’intervention ou de revendications politiques, tant en ce qui concerne l’actuel président Joe Biden – qui s’était proclamé comme le plus pro-syndical depuis l’époque de Lyndon Johnson dans les années 1960 et qui a effectivement manifesté sa proximité avec les travailleurs de l’automobile pendant leur grève de trois semaines – qu’en ce qui concerne le risque, perçu à juste titre comme catastrophique, d’une victoire de Donald Trump. La politique, au sens classique du terme, a tout simplement été la grande absente de ces trois jours à Chicago. La raison en est probablement à chercher dans l’idée – assez typique pour les États-Unis – que les travailleurs et leurs représentants syndicaux, doivent avant tout être capables de se débrouiller tout seuls, d’affronter les directions d’entreprises et de chercher des solutions à leurs problèmes sans placer trop d’espoirs dans les choix des gouvernements « amis », ni de détourner les forces et les énergies dans un affrontement forcément inégal avec des exécutifs hostiles. La nature structurellement décentralisée de l’État (ainsi que du syndicalisme et des relations industrielles nord-américaines) dans laquelle l’action collective a toujours été confrontée à une lourdeur délibérée des procédures d’accès à la représentation sur le lieu de travail et – surtout – à l’hostilité virulente des patrons à l’égard de l’implantation syndicale et de la grève, y a évidemment contribué.
Dans de nombreux États, au nom d’un « droit au travail » mal compris (et légalement validé), les employeurs peuvent tout faire pour briser les grèves et refuser les demandes de reconnaissance syndicale ou de représentation, y compris en ayant un recours systématique à des briseurs de grève. Les employeurs sont dès lors la première et véritable cible de l’action syndicale et c’est seulement en second lieu que la puissance publique est interpellée, avec peut-être une exception du côté des enseignants et du personnel hospitalier. Globalement, ce retour du syndicalisme réussit d’autant plus qu’il arrive à transcender les clivages et à articuler une dimension intersectionnelle de classe, de genre et de race (selon leur lexique).
SE MOBILISER POUR GAGNER
L’enquête ouvrière, la confrontation des expériences de mobilisation et la discussion sur les objectifs à atteindre ne sont jamais dilués ou dispersés en mille ruisseaux mais sont, comme on ils le disent eux-mêmes « focalisés » sur objectifs concrets que le mouvement syndical peut réaliser en construisant un rapport de force à partir de la base. Cette approche pragmatique n’est pas si nouvelle, puisqu’on la retrouve à l’époque où John Commons, Selig Perlman, Samuel Gompers et Walter Reuther avaient défini les grandes orientations de l’AFL-CIO et qui se distinguait de l’approche syndicale européenne, traditionnellement sceptique à l’égard d’un syndicalisme centré uniquement sur les questions matérielles (bread and butter, les questions de beurre et de pain) et très peu marqué idéologiquement[4].
Aujourd’hui, cette approche « volontariste » qui consiste à initier la négociation collective dans un objectif réaliste et concret est ravivée à une sauce radicale et s’éloigne des incrustations hyper-bureaucratiques et pseudo-participatives que nous avions appris à connaître à l’époque où Sergio Marchionne, patron italien de la Fiat-Chrysler, en vantait les vertus et la valeur exemplaire à Détroit.
Une partie de l’ancienne direction syndicale de l’UAW – il faut peut-être le rappeler ici en passant – a connu une fin pitoyable, et poursuivie par des scandales et des condamnations diverses, pour avoir échangé des concessions sur la peau des travailleurs pour leur profit personnel.
UN HORIZON D’ESPOIR
Aujourd’hui, l’UAW renoue avec des combats victorieux, et ce de manière éclatante, qui peut offrir un modèle syndical pour les autres secteurs. Ce syndicalisme est aussi, de manière décisive, une source d’espoir. L’UAW a organisé trois semaines de grèves en crescendo, avec des caisses de grève couvrant 500 dollars par semaine pour chaque gréviste – mais est-ce que quand réfléchirons-nous à cet outil utilisé dans tant de pays autrefois? – à obtenir 25% d’augmentations salariale chez les trois constructeurs, étalés en quatre ans et demi (+11% immédiatement) ; la réintroduction de l’échelle mobile des salaires (le fameux “COLA” : Cost-Of-Living-Adjustment) une amélioration des conditions de travail ; la fin du système dualiste two tier (basé sur une double grille de salaire essentiellement basé sur l’ancienneté) ; l’augmentation du salaire horaire d’embauche qui passe de 16,25 $ à 22,50 $/heure ; voire, enfin, le remboursement de 110 $ par jour, perdus lors des piquets de grève. La convention collective fut adopté à une large majorité dans toutes les usines des trois constructeurs. Les victoires, dans les mobilisations syndicales, sont d’une importance fondamentale et surtout, elles sont contagieuses. « Nous avons enfin mis fin à 40 ans de concessions et de reculs. C’est la meilleure convention de toute ma vie », témoigne un cadre syndical déjà âgé de la General Motors.
Le succès contre les trois géants de l’industrie automobile a déclenché une réaction en chaîne. Le vendredi 19 avril, en pleine séance plénière, la nouvelle de reconnaissance syndicale chez Volkswagen à Chattanooga a été accueillie par des cris de victoire dans l’auditorium ; et pour cause… Avec 70 % de voix en faveur de l’adhésion du syndicat sur les 4 300 employés de l’usine, l’UAW a enfin un pied dans l’entreprise qui fut pendant longtemps un exemple d’un management sans interlocuteur avec des travailleurs sans représentation. Le prochain objectif est maintenant d’obtenir le même résultat chez Mercedes à Vance, dans l’Alabama. Il est frappant de constater que les géants allemands de l’automobile, champions de la concertation sociale dans leur pays et en Europe, viennent dans les états du Sud des États-Unis chercher des conditions de non-représentation syndicale typique des pays du sud global.
À CHICAGO ET DANS LE MONDE ENTIER
A Chicago, il y avait de nombreux représentants et de de délégations syndicales de différents pays ; évidemment du Mexique – avec une cinquantaine d’ateliers étaient uniquement en espagnol, notamment en raison de la forte présence de travailleurs latinos –, mais aussi du Japon, de la Corée du Sud et de l’Europe. Citons notamment United du Royaume-Uni, Yanira Wolf, la secrétaire générale de Ver.di d’Allemagne, ainsi que divers représentants d’IG Metal, de la Fondation Rosa Luxemburg, l’IF-Metall suédois, notamment pour rendre compte de la grève chez Tesla (saviez-vous que ce syndicat dispose d’une caisse de grève d’un milliard et demi d’euros ?), la CGT de France, la CGIL d’Italie avec une délégation de la Fiom (fédération des métallurgistes) et moi-même, pour la Fondation De Vittorio de la CGIL, pour intervenir compte dans un atelier international d’une série d’expériences réalisées au cours de ces dernières années.
Les propos tenus par notre camarade Michele De Palma, lors de la dernière plénière du dimanche matin ont suscité beaucoup d’intérêt, voire d’enthousiasme, avant que la star de cet événement, Shawn Fain, clôture la conférence. Son accession à la présidence de l’UAW, il y a deux ans, a été rendue possible par la mobilisation d’une tendance radicale et critique des anciennes méthodes de direction. En effet, le courant Unite All Workers for Democracy (UAWD) rejetait en bloc toute la dérive bureaucratique et accommodante, en défendant un militantisme et une démocratie interne, par le bas, combinée à une stratégie offensive, et qui sont devenues les lignes directrices d’un redressement syndical qui n’a pas tardé à produire ses fruits, à commencer par la convention collective déjà évoqué contre les trois géants de l’automobile.
LA FORCE DE SHAWN FAIN
La posture et les discours de Shawn Fain sont un hommage vivant à la classe laborieuse et aux gens ordinaires. Dans ses interventions, il prononce des phrases d’une grande clarté, qui réchauffent le cœur et suscitent un enthousiasme contagieux. « Nous sommes ici pour mettre fin au syndicalisme d’entreprise, aux concessions sans fin, à la corruption syndicale et pour briser les chaînes qui nous ont emprisonnés. J’ai dit à maintes reprises que la négociation de bonnes conventions nous porte vers d’autres victoires et des succès, y compris sur le plan organisationnel. Ces deux choses vont de pair. De ce point de vue, notre grève de septembre n’était pas seulement dirigée contre les trois géants de l’automobile. Elle était la grève de l’ensemble de la classe laborieuse, du monde du travail. Et c’est la preuve d’une chose : la classe des travailleurs peut gagner. Elle peut changer le monde. Nous ne gagnerons jamais en jouant sur un mode défensif ou en nous contentant de réagir aux événements. Nous ne gagnerons jamais en jouant les bons élèves biens gentils avec les patrons. Nous ne gagnerons jamais en disant à nos membres ce qu’il faut faire, ce qu’ils doivent dire ou penser. Nous gagnerons en donnant aux travailleurs les outils, l’inspiration et le courage de se défendre. De ce point de vue, je pense que la classe des travailleurs est en quelque sorte l’arsenal de la démocratie et que les travailleurs en lutte sont les « libérateurs ».
Shawn Fain a reçu une ovation de la salle entière qui, debout, a entonné des chants en chœurs à l’issue de ce discours aussi sincère que combatif. Pour couronner le tout, Fain a proposé que l’ensemble des syndicats fassent expirer leurs conventions collectives le 30 avril 2028, date à laquelle la convention collective avec les trois grands de l’automobile tombe à échéance, afin que le 1er mai 2028 devienne un jour de grève générale unitaire, menée partout dans l’ensemble du pays.
LE RISQUE TRUMP
Certes, pour l’instant, les données sur le taux de syndicalisation n’indiquent pas de variations significatives, et gravitent autour de ce modeste 12% – en grande partie grâce à la forte contribution des employés publics (syndiqués à 33%) – et il pourrait y avoir de sérieuses répercussions si une élection de Trump devait se traduire par une recomposition pro-patronale du crucial Industrial Relation National Labor Relation Board. En effet, cette institution fédérale préside à l’admission des bulletins de vote permettant de reconnaître le syndicat sur le lieu de travail lors d’une consultation des travailleurs ; en vérifiant également la régularité des suffrages et des décomptes. Mais pour l’heure, le public de militants syndicaux ardents et enthousiastes savoure ce moment de succès inespéré, après les nombreuses, trop nombreuses années d’amertume du passé.
Il y avait un beau soleil à Chicago, à l’extérieur de l’hôtel Hyatt, parmi les parterres de fleurs des nombreux parcs de cette ville impressionnante. Nous verrons si c’est le signe annonciateur d’un nouveau printemps durable pour le mouvement syndical américain. Dans l’espoir que ses récentes réalisations s’expriment et se répercutent également chez nous. Pour le travail militant et les luttes qui nous attendent. Mais ici, à Chicago, nous avons découvert des modalités de mobilisation et de rassemblement, qui en termes de format organisationnel et, surtout, en termes de contenu, ne seraient pas inutiles d’être examinées de près, selon le meilleur esprit de comparaison et d’apprentissage mutuel et émulatif.
Salvo Leonardi, Fondation Di Vittorio – CGIL
article publié par Collectivo; traduit de l’italien par Stéphen Bouquin
[1] SEIU (Service Employees International Union) ou Union Internationale des Employés des Services est un syndicat nord-américain représentant 2,2 millions de travailleurs exerçant plus de 100 professions différentes aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada.
[2] Change to win est une centrale syndicale américaine formée en 2005 par des syndicats dissidents de l’American Federation of Labour – Congress of Industrial Organisations dont l’Union internationale des employés des services et les International Brotherhood of Teamsters. Le syndicat des travailleurs de l’automobile est resté affilié à la confédération AFL-CIO mais s’est élargi à d’autres secteurs comme par exemple les travailleurs du monde universitaire.
[3] La Fondation porte le nom du président de la CGIl de l’après-guerre ; Giuseppe Di Vittorio était un homme politique de gauche, antifasciste et syndicaliste italien. Contrairement à la majorité des syndicalistes du XXᵉ siècle issus de la classe laborieuse, Di Vittorio vient de la paysannerie. Militant communiste, il quittera la PCI après les évènement de Budapest en 1956 pour rejoindre le Parti Socialiste Italien. https://www.fondazionedivittorio.it/it
[4] Mais elle n’est pas si étrangère que cela à notre tradition italienne – ou allemande –puisque Gino Giugni, le grand maître du droit syndical italien, considéré comme le père du statut des travailleurs salariés de 1970, était parti étudier à l’université du Wisconsin où il a appris les leçons du syndicalisme américain fondé sur l’institutionnalisme volontariste théorisé par John Commons et surtout par Selig Perlman. Dans les années suivantes, Gino Giugni deviendra le théoricien de « l’autonomie collective » et de « l’inter-syndicalisme » ; c’est-à-dire d’un système de relations professionnelles entièrement centré sur la capacité autonome des partenaires sociaux à réguler les relations de travail, le rôle de l’État se limitant à produire une législation facilitant la négociation collective, du type de la loi Wagner rooseveltienne de 1935. Bien sûr, cette approche avait aussi ses faiblesses puisqu’elle n’a jamais posé la question du degré de couverture des conventions collectives et elle a laisse le champ libre au patronat de transférer la production dans les états du sud, où la présence syndicale est restée très faible jusqu’à très récemment


