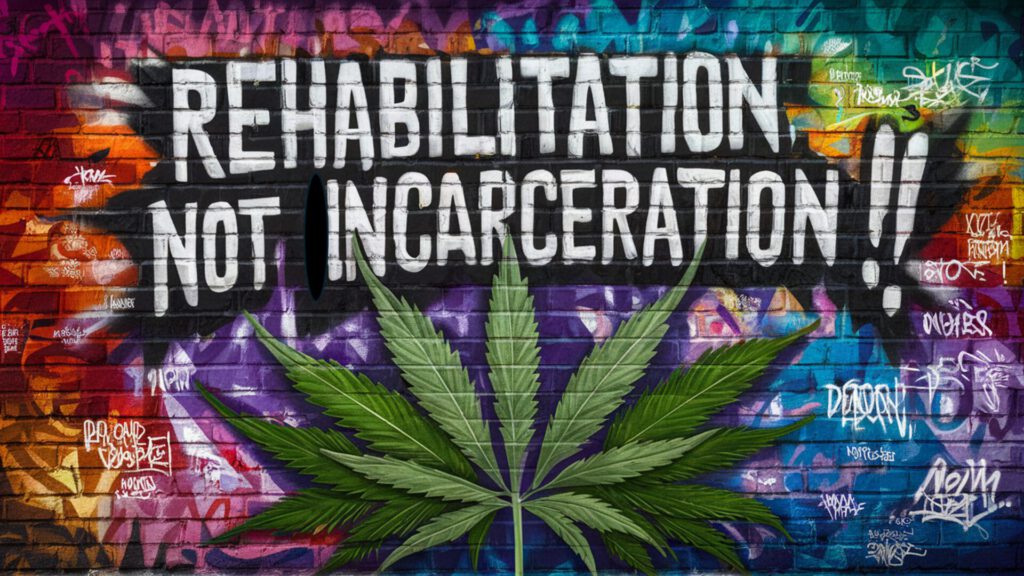Avant le XXe siècle, la Belgique, comme d’autres pays européens, ne semble pas confrontée à la consommation de drogues qui reste confinée au monde médical. Le vocable drogue y apparait de manière parcimonieuse et avec une telle confusion qu’il est difficile de lui attribuer une quelconque signification : on parle tantôt de médicaments, de drogues, de poisons, tantôt de produits toxiques, de substances vénéneuses ou soporifiques. L’extrait de chanvre indien, par exemple, est classé comme médicament et l’herbe de chanvre indien est considérée comme une substance toxique ou un poison. Les quelques réglementations existantes, comme la loi du 12 mars 1818, relèvent du domaine de l’art de guérir et visent avant tout à protéger le consommateur contre les pratiques illégales de la médecine et à assurer la délivrance et la vente de médicaments par des professionnels de la santé. L’usage de drogues n’est jamais abordé en tant que tel et il n’est pas question de sanctionner le consommateur qui se serait procuré des substances en dehors du prescrit légal. La pression du milieu international va cependant amener la Belgique à revoir son arsenal législatif.
La criminalisation des drogues : une conduite dictée par le droit international
Le 1er décembre 1911 se tient à La Haye, à l’initiative des États-Unis, la Conférence internationale « en vue de l’adoption des mesures propres à amener la suppression progressive de l’abus de l’opium, de la morphine, de la cocaïne, ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances ». La Belgique, n’ayant aucun intérêt dans le commerce de l’opium, n’y est pas présente. Tout en reconnaissant que « les mangeurs et les fumeurs d’opium ne se rencontrent pas dans notre pays », le gouvernement belge signe la Convention internationale de l’opium du 23 juin 1912 afin de répondre à l’appel international invitant tous les États à lutter contre l’abus d’opium. La ratification de la convention contraint la Belgique à modifier sa réglementation. Elle s’exécute en adoptant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de drogues, appelée communément la « loi sur les stupéfiants », afin de s’aligner sur ses partenaires européens et notamment sur son voisin français. En résulte l’adoption de dispositifs inadaptés à la situation belge, comme en témoigne l’incrimination de l’usage de substances illégales en société ou la facilitation à autrui de l’usage de ces substances en procurant un local, censée lutter contre les fumeries d’opium, inexistantes sur le sol belge.
La loi du 24 février 1921 marque un véritable tournant dans la manière d’aborder le phénomène des drogues qui ne relève plus de l’art de guérir, mais vise à lutter contre le trafic de drogues à travers l’incrimination d’un certain nombre de comportements. La détention de substances illégales est dorénavant passible de peines d’emprisonnement. Les peines se veulent dissuasives de façon à « mettre ces pénalités en rapport avec la valeur actuelle de l’argent et la dépravation morale de notre époque » et leur sévérité est dictée par « l’extrême gravité des méfaits de ceux qui se livrent au trafic de ces substances particulièrement nuisibles » .
Si la Belgique s’est dotée d’un dispositif répressif important dès 1921, celui-ci sera très peu mobilisé à l’encontre des usagers de drogues.
Si la Belgique s’est dotée d’un dispositif répressif important dès 1921, celui-ci sera très peu mobilisé à l’encontre des usagers de drogues. Deux raisons semblent expliquer cet écart entre les processus de criminalisation primaire et secondaire. D’une part, la Belgique semble plus préoccupée par les troubles sociaux et politiques qui la secouent dans les années 1920. Comme le soulignent Christian de Valkeneer et Lode Van Outrive : « De ce fait, on s’intéresse beaucoup plus au maintien de l’ordre public et au contrôle politique qu’à la lutte contre la criminalité. » D’autre part, au moment de la construction de l’interdit pénal en matière de drogues, le problème de la drogue n’est pas associé dans les discours politiques aux questions de sécurité et de délinquance. C’est davantage l’alcoolisme qui fait office de problème majeur et pas l’usage de drogues. Conformément aux objectifs des conventions internationales que la Belgique vient de souscrire, l’application du dispositif juridique en matière de drogues sera réservée aux professionnels de la santé dans l’optique de contrôler le commerce intérieur des substances. Quand répression il y a, c’est bien plus le corps médical que l’usager qui en fait les frais : médecins et pharmaciens sont ainsi poursuivis pour « entretien de toxicomanie ». Et si l’usager de drogues fait parfois la rencontre des autorités judiciaires, c’est plus au titre de la défense sociale et de la dangerosité potentielle que trahit son comportement qu’en raison d’une infraction à la loi pénale. Certains usagers seront ainsi internés ou colloqués dans des établissements spécialisés, ce qui témoigne à nouveau de la médicalisation, à l’époque, de comportements jugés déviants ou portant atteinte à la moralité et à la sécurité publiques.
Les années 1960 et 1970 : un contexte favorable à la répression
Un peu partout en Europe, on questionne la pertinence de sanctionner les usagers et l’utilité de les mettre en prison
Après une éclipse du problème « légal » de la drogue pendant plus de quarante ans, la question revient progressivement à l’agenda politique dans les années 1960 et surtout dans les années 1970, qui connaissent le renforcement du dispositif répressif envers les drogues. Comme la plupart des pays européens, la loi belge du 9 juillet 1975 s’inscrit dans un contexte international et transpose, en droit belge, les conventions des Nations unies en matière de drogues, soit la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971. La loi de 1975 introduit diverses innovations afin « d’atteindre avec plus d’efficacité les modalités nouvelles de la délinquance en ce domaine » et l’introduction de peines « extrêmement spectaculaires » sont justifiées par « les développements inquiétants du trafic des drogues et l’usage qui en est fait dans notre pays ». Il ne faudrait cependant pas surestimer le poids des conventions internationales. Adoptée quatorze ans plus tard que la Convention de 1961, la loi de 1975 traduit aussi l’inquiétude croissante de la classe politique face à la hausse de consommation de drogues, particulièrement du cannabis. Dans le contexte des luttes sociales et politiques qui secouent la Belgique dans les années 1970, la drogue est associée à une contre-culture de la jouissance et de la contestation et le renforcement du dispositif répressif semble avant tout répondre à un souci croissant de maintien de l’ordre social et de restauration des valeurs.
L’application progressive de la loi sur les drogues sera concomitante de sa mise en cause : un peu partout en Europe, on questionne la pertinence de sanctionner les usagers et l’utilité de les mettre en prison, pour prôner une approche davantage multidisciplinaire. Ces questionnements ne déboucheront pas nécessairement sur des politiques de dépénalisation de la réaction sociale et peuvent même être perçus comme des tentatives de légitimation de l’interdit pénal, débouchant sur une logique hybride, actuellement toujours présente : on hésite entre la figure d’un usager de drogues « coupable », justifiant le renforcement du dispositif répressif, et celle d’un usager « malade », nécessitant une prise en charge médicale. Par ailleurs, la mise en place de dispositifs thérapeutiques, loin de se substituer à la sanction pénale, vient plutôt s’y superposer, conduisant à l’extension du filet pénal.
Les années 1990 : l’usage de drogues au cœur des politiques sécuritaires
La question des drogues s’invite à nouveau dans les débats politiques dans les années 1990, notamment à la suite des déclarations du député Patrick Moriau en faveur de la dépénalisation du cannabis, et débouchera sur la création en 1996 d’un groupe de travail parlementaire chargé d’étudier la problématique de la drogue. Considérant que la justice ne peut ni ne doit être le seul instrument de régulation sociale et qu’il n’est ni utile ni efficace de vouloir tout régler par la voie pénale, le groupe de travail estime que l’usage de drogues ne constitue pas en soi un motif justifiant une intervention répressive sauf si l’intéressé a commis des infractions qui perturbent l’ordre social .
Les conclusions ne débouchèrent cependant pas sur une modification législative, mais sur l’adoption de directives de politique criminelle qui caractérisent, encore aujourd’hui, la gestion du contentieux des drogues. Dans le contexte des années 1990 où l’usager de drogues apparait comme une des principales figures de l’insécurité, la Belgique fait le choix, comme d’autres pays européens, de ne pas toucher aux incriminations légales pour se contenter d’aménager la politique des poursuites. L’interdit pénal reste de mise, même si les acteurs de terrain sont invités à faire preuve de tolérance, à tout le moins à l’encontre des usagers de cannabis.
L’usage de drogues au XXIe siècle : encore et encore une priorité de politique criminelle
Plus de la moitié de la population pénitentiaire belge est incarcérée pour des faits de drogues.
Si aujourd’hui la drogue ne constitue plus la préoccupation majeure des politiques répressives, elle n’en reste pas moins inscrite à l’agenda politique au nom d’une association entre usage de drogues et insécurité qui ne disparaît pas. Ceci explique que, même si un discours de tolérance peut émerger à l’égard de l’usage de certaines substances, même si se profile le souci de réduire les risques sanitaires liés à l’usage clandestin de substances illicites, c’est toujours à l’intérieur du cadre pénal que se déploient les politiques dites alternatives. Et force est de constater sur le terrain que la lutte contre les drogues constitue encore une priorité de politique criminelle faisant des drogues un contentieux alimentant régulièrement les cours et tribunaux. Les drogues se classent ainsi, dans les statistiques policières, dans le top cinq des infractions après le vol, les dégradations contre la propriété, les infractions contre l’intégrité physique et bien avant les infractions en matière de fraude et les infractions contre la sécurité publique . La détention de drogues reste par ailleurs une cible prioritaire pour la police, ce qu’elle confirme régulièrement dans ses rapports sur les tendances en matière de criminalité : « Les faits de détention et de commerce de drogues […] se maintiennent à ce nombre élevé. Étant donné que les drogues sont un phénomène typique de criminalité quérable, cela signifie que la police continue en permanence à consacrer une forte attention à ce phénomène. » Le même constat est posé par l’asbl Eurotox : la majorité (environ 74 %) des infractions enregistrées au niveau national ainsi qu’en région bruxelloise en 2019 concernait des faits de détention. Une tendance similaire est posée au sein de l’Union européenne. Une étude de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relève que les infractions à la législation sur les drogues signalées au sein de l’Union européenne connaissent une progression de presque un quart (24 %) depuis 2009 ; la plupart de ces infractions (82 %) concernent la consommation ou la possession de drogue pour usage personnel et le cannabis représente les trois quarts des infractions de consommation ou de possession pour lesquelles la drogue est connue.
Les statistiques du Conseil de l’Europe nous enseignent par ailleurs que plus de la moitié de la population pénitentiaire belge est incarcérée pour des faits de drogues. Alors que la moyenne européenne tourne autour des 19 %, la Belgique occupe le haut du podium . L’occasion nous est ainsi donnée de rappeler – contrairement à ce que d’aucuns voudraient nous faire croire – que nous sommes loin d’une situation d’impunité et que les prisons – au demeurant surpeuplées – regorgent de personnes condamnées sur la base d’une loi vieille de plus de cent ans.
Christine Guillain
Santé conjuguée n°106 – mars 2024
Source : https://www.maisonmedicale.org/de-la-demedicalisation-a-la-criminalisation/