« … donner des mots au monde qui vient. »
Nous sommes amenés à échanger avec des groupes se revendiquant de la « transition », que celle-ci fasse référence directe à Rob Hopkins, au mouvement Colibri, ou encore aux « simplicitaires » ou « décroissants ». Pour plusieurs projets concrets, il était d’ailleurs remarquable que les personnes ne savaient pas clairement si l’activité était réalisée au nom de Colibri, de la transition, du GAC[1] ou d’une locale écolo ! Les personnes fondant des projets de transition n’y arrivent pas vierges d’engagement, de recherche, ni d’expérience ; elles ont en général un passé riche de mobilisations et de militances diverses, de tâtonnements, et de pratiques.
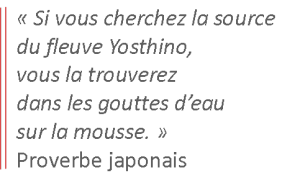
Le cadre : répondre aux défis de l’époque
La transition telle que proposée par Rob Hopkins invite à prendre en compte principalement deux donnes : la fin de l’énergie bon marché et le réchauffement climatique. Ces deux thèmes mettent en évidence la raréfaction des ressources naturelles (nous vivons dans un monde fini : pic du pétrole, cuivre, phosphore,…) et l’action sur l’environnement du modèle dit de développement actuel (il pollue et détruit : saturation des puits d’absorption de la pollution). La prise en compte d’une situation « catastrophique », comprise ici comme un moment de bifurcation lié à des impasses (climatique, énergétique, démographique, biologique, économique, sanitaire…) semble constituer sinon un point de départ, au moins une composante de ce mouvement. La transition est fille de l’écologie environnementale. En posant ces préoccupations, ce mouvement ajoute des questions nouvelles aux débats sur le changement : il ne s’agit plus de penser seulement à la répartition du gâteau (comme le dit si bien Serge Latouche), c’est-à-dire aux questions de redistribution, de justice, d’attention aux plus démunis, mais aussi de questionner la recette et les ingrédients dudit gâteau ! Et cette nouveauté chamboule tous les repères habituels et tous nos équilibres.
Il faut mentionner une troisième question que nous pourrions nommer « l’identité du pâtissier » : qui produit, comment, et est satisfait par quoi ? Multinationales ou artisans, industrie ou agriculture, artificialisation à outrance ou agroécologie, joie de faire ou de consommer ?
Pas mal de similitudes avec l’ancienne grille d’Ivan Illich (une des références de Rob Hopkins), qui invitait à penser trois dimensions du choix public : celui de la hiérarchie sociale (qui obtient quoi ?), celui des choix techniques (les moyens, le comment), et enfin celui de la nature de la satisfaction (avoir ou faire).
Foutue complexité
Avouons que répondre aux défis de l’époque est complexe et que ce mélange de répartition, de recettes et d’identité des pâtissiers complique bien les choses ; les frontières entre politique et sciences, humains et non-humains, économie et droit, deviennent caduques, les domaines si bien répartis s’imbriquent : une simple fraise d’Alméria est un triste composé de technique de pointe (plants clonés à Davis, Californie, et transportés par avions frigos), de pétrole (40 calories fossiles/calorie alimentaire pour le plastique, les engrais, les pesticides, les transports), de subsides européens, espagnols et andalous pour ce beau projet de développement, de travailleurs roumains ou marocains (jusqu’à cinq travailleurs à l’hectare en pleine période de production), de déficits nutritionnels, de pertes d’emplois chez les petits producteurs du reste de l’Europe, de pollutions et de santé publique (province de Huelva classée parmi les taux de cancer les plus élevés en Espagne). Liste non exhaustive.
Impossible de ne pas citer Bruno Latour concernant cette complexité : « Jusqu’ici, la radicalité en politique voulait dire qu’on allait “révolutionner”, “renverser” le système économique ». Ce que nous avons à mettre en œuvre est d’un tout autre ordre : la crise écologique nous oblige « à une transformation si profonde qu’elle fait pâlir par comparaison tous les rêves de “changer de société”. La prise du pouvoir est une fioriture à côté de la modification radicale de notre “train de vie”. Que peut vouloir dire aujourd’hui “l’appropriation collective des moyens de production” quand il s’agit de modifier tous les moyens de production de tous les ingrédients de notre existence terrestre ? D’autant qu’il ne s’agit pas de les changer “en gros”, “d’un coup”, “totalement”, mais justement en détail par une transformation minutieuse de chaque mode de vie, chaque culture, chaque plante, chaque animal, chaque rivière, chaque maison, chaque moyen de transport, chaque produit, chaque entreprise, chaque marché, chaque geste » (Le Monde, 4 mai 2007)
Une fraise accessible, savoureuse et nutritive pose donc des questions techniques (comment produire ?), sociales (par qui, pour vendre à qui, à quel prix ?), environnementales (avec quels impacts, nécessitant quels intrants ?), etc., donc des questions aussi politiques. L’imaginaire de la transition est fille de la complexité !
Un changement de culture
Faut-il dès lors parler d’un changement de paradigme, d’une nouvelle culture à construire, d’une nouvelle vision globale à mettre à l’œuvre, d’inventer d’autres mondes ? Il s’agit en tout cas de modifier en profondeur nos modes de vie. Ceux-ci ne sont ni généralisables, ni soutenables, ni souhaitables. Comment réinventer une culture ? Comment œuvrer à un projet de société sobre, frugal, solidaire, qui remet radicalement en question la mythologie et la religion occidentale du « plus = mieux » ? Le mouvement de la transition propose des approches, si pas nouvelles, renouvelées de ce qu’est le changement, ses acteurs et leurs stratégies, en sortant des frontières institutionnelles et épistémologiques dominantes.
Des pratiques des laboratoires : le changement par le bas, les niches, les noyaux, les interstices, les fissures, les failles
(suivant les différents vocabulaires!)
Qui sont les acteurs des changements ? Quels sont les sujets de l’agir ? Quels changements sont soumis à la volonté de qui ou à un vouloir quelconque ? Les acteurs décisifs sont-ils « en haut », suivant une vision commune (mais que font les politiques ?), en « bas » (le peuple, mais lequel ?) ou à concevoir comme des noyaux, des centres actifs, des cellules éparses ? Quels changements sont de l’ordre de processus, multiples et décentralisés ? Si « le monde est bien davantage modifié par des processus sans sujets que par des grands hommes ou des groupes militants », comme l’écrit Miguel Benasayag, il faut penser l’engagement différemment, non dans une optique de maîtrise des évolutions en cours, mais comme intrinsèquement situés en elles.
Les mouvements se revendiquant de la transition semblent tous, plus ou moins, accorder une importance majeure à l’action citoyenne et à l’organisation de la société civile et n’attendent pas que les décisions adéquates viennent du monde politique. La transition est fille de l’auto-organisation citoyenne. Cela rejoint et s’accorde à divers autres mouvements, comme le mouvement zapatiste et des mouvements d’Amérique Latine (Forums sociaux) théorisés par des auteurs comme Jérôme Baschet, Chico Whitaker , John Holloway, Boaventura de Sousa Santos, etc. Ceci trouve une formulation en sociologie avec la théorie des « niches ». Les nouveaux sujets de l’agir sont les situations concrètes et vécues mobilisant des personnes, des contextes, des lieux singuliers. Ces trente dernières années, des groupes sociaux précis ont organisé des changements non prévus dans la pensée classique du changement : les femmes, les paysans, les homosexuels, les afro-descendants,… en s’organisant de manières totalement différentes (communautés locales, autogestion, organisations coopératives, pétitions) de celles privilégiées par la théorie critique classique (voie politique des partis et action institutionnelle, lutte violente, syndicats). Les pratiques développées dans ce milieu de personnes « qui ont décidé de vivre différemment de leurs contemporains et faire des choix de vie qui les mènent à s’engager dans des activités concrètes » nous questionnent quant à notre besoin « d’une manière alternative de penser les alternatives » (Boaventura de Sousa Santos).
Une stratégie des petits matins versus stratégie du grand soir ! Ou un certain renoncement au Pays des Merveilles.
La notion de progrès linéaire, de lendemains enchanteurs, s’est effondrée et ce petit milieu partage certainement bien plus les idées de la collapsologie (discipline d’étude des effondrements de nos sociétés) que celles d’un progrès futur lumineux. Il faudra faire avec moins, sobrement, redéfinir les notions de prospérité, de bonheur, et d’émancipation. Le combat ne porte plus sur la construction d’une société idéale mais sur l’aménagement de la réalité d’aujourd’hui en vue de s’adapter aux « chocs » à venir. Il s’agit d’agir ici et maintenant pour créer de nouveaux possibles par des stratégies de recherche, de petits pas, dans toutes les dimensions de vie : comment se nourrir, se déplacer, se loger, se vêtir, faire société… ?
Les mouvements de la transition s’accordent sur l’importance donnée aux moyens, de construire des cheminements autant que des horizons. « Le combat s’est déplacé d’une lutte pour la prééminence des fins à une rivalité pour la justesse des moyens[2] » écrit Pascal Chabot.
Résistance créatrice, Expérimentation anticipatrice, Vision transformatrice
La transition nous semble donc un processus en marche, multiple et diversifié, s’adaptant aux singularités locales et permettant aux populations d’explorer et d’imaginer des réponses et des projets novateurs. Et ceci dans un triple mouvement, si bien exprimé par Patrick Viveret : « Celui de la résistance créatrice, de l’expérimentation anticipatrice et de la vision transformatrice. Ces trois éléments sont inséparables. Une résistance sans perspective et sans expérimentation devient une simple révolte, souvent désespérée et désespérante. Une vision transformatrice sans résistance et sans expérimentation devient un simple horizon idéal sans traduction incarnée. Une expérimentation coupée de la résistance créatrice et de la vision transformatrice devient une soupape de sûreté ou une caution du système dominant sans capacité à le transformer ».
Et si l’histoire commençait parfois par un murmure ?
Rencontre des Continents
Rencontre des Continents participe à cette mouvance de personnes « qui ont décidé de vivre différemment de leurs contemporains et faire des choix de vie qui les mènent à s’engager dans des activités concrètes et la mise en place d’alternatives ». Leur thème de prédilection étant « une assiette pour notre santé, celle de la planète et de tous ses habitants », ils sont attentifs à nos modes de vie. Les alternatives concrètes pour une alimentation de qualité réunissent une large gamme d’acteurs : circuits courts, soutien aux agriculteurs et maraîchers, magasins alternatifs, luttes paysannes et mouvements pour la souveraineté alimentaire, syndicats paysans… et groupes de transition.
[1] Groupe d’Achat en Commun.
[2] Pascal Chabot, L’âge des transitions, PUF, 2015.

