Reste en définitive « le recyclage des déchets ». [Voir les deux premières parties de cet essai, publiées sur ce site les 16 et 17 mai 2023.] Il suppose la récupération des matériaux constituant les objets en fin de vie susceptibles d’entrer dans un nouveau procès de production. En sont donc exclues les opérations de valorisation énergétique des déchets (leur combustion) ou leur emploi dans des opérations de remblaiement ou d’enfouissement.
Limites et perversité du recyclage
Commençons par remarquer que, contrairement à ce que laissent entendre la notion d’« économie circulaire » et, plus encore, le slogan stupide « 100 % recyclable » de plus en plus souvent apposé sur les marchandises, la récupération des matériaux par recyclage des déchets qu’ils constituent au terme de leur cycle de vie ne saurait être parfaite (complète). D’une part, une partie de ces matériaux se disperse inévitablement au cours de l’usage même des objets qu’ils constituent et ce bien avant que ces derniers deviennent des déchets hors d’usage : la lame du couteau usagé perd de sa largeur au fil de son utilisation et de ses aiguisages successifs ; les matières textiles de nos vêtements se dispersent pour partie sous l’effet des frottements liés à leur port et à leurs lavages répétés ; lorsqu’on les remplace en les récupérant pour recyclage, les plaquettes de frein n’ont plus leur épaisseur initiale ; etc.
D’autre part, certains matériaux ne se recyclent que difficilement, du fait qu’ils se trouvent mêlés à d’autres matériaux ; c’est le cas des alliages métalliques, s’il s’agit d’en extraire séparément les métaux qui les composent ; c’est le cas de tous les matériaux auxquels sont ajoutés des additifs (solvants, colorants, etc.) qui les rendent impropres à certains recyclages (par exemple dans l’industrie agroalimentaire) : ainsi de la plupart des plastiques ; c’est le cas surtout des emballages qui mêlent souvent en couches inextricables bois, métaux et plastiques (une simple canette de bière en aluminium est entourée à l’extérieur d’une couche de vernis et à l’intérieur d’une couche de plastique pour éviter le contact du breuvage avec le métal). Ou encore, les recyclages successifs dégradent la qualité du matériau qui ne peut en subir en conséquence qu’un nombre limité : c’est le cas du papier (recyclable au mieux cinq fois) tout comme des plastiques PET (polyéthylène téréphthalate), pourtant les plus recyclables des plastiques, et même du verre (sa transparence s’altère sauf à ce qu’il soit strictement trié par couleur) ; ce qui nécessite le recours à des adjonctions de matière première vierge à chaque recyclage. Le recyclage est même impossible lorsque les matériaux sont irrécupérables parce que dispersés en quantités infimes dans la masse d’autres matériaux ; c’est le cas là encore des métaux employés sous forme de poudres ou de fils très fins dans la confection de peintures, de plastiques, de cosmétiques, de textiles, etc. : ce sont ainsi 20 % du cadmium et 95 % du titane utilisés dans le monde qui se trouvent irrémédiables perdus (Berlingen, 2020 : 61).
Enfin, les opérations de recyclage engendrent elles-mêmes des pertes (rejets et déchets) de matières tout comme des dissipations d’énergie, à l’instar de toutes les opérations productives. Sans compter qu’elles peuvent engendrer de nouveaux dégâts écologiques (prélèvements inconsidérés de matières premières, rejets de déchets toxiques et de polluants), notamment quand elles sont délocalisées dans les formations périphériques présentant un bas niveau de réglementation en matière de protection de l’environnement.
En conséquence, le recyclage ne peut nullement réaliser « une empreinte écologique neutre » comme le suggère l’article L. 110-1-1 du Code de l’environnement (cité par Benady et Ross-Carré, 2021 : 2) : il ne supprime pas la nécessité de procéder sans cesse à de nouveaux prélèvements de matières premières, générateurs de rejets supplémentaires ; tout au plus peut-il en réduire le volume et le rythme. Mais ces nouveaux prélèvements seront d’autant plus importants que la « croissance économique » sera gourmande en matières premières, jusqu’au point de rendre éventuellement dérisoires les effets bénéfiques (en termes de réduction des prélèvements des ressources naturelles) opérés par le recyclage. Ainsi, recycler à 80 % un matériau au bout de vingt ans d’usage ne conduit pas à réduire, au terme de cette durée, des quatre cinquièmes le prélèvement additionnel sur les ressources naturelles destiné à composer les pertes et fuites intervenues si, entre-temps, la consommation productive de ce matériau s’est accrue ; bien plus, si le taux annuel de croissance de cette dernière a été en moyenne de 3 % pendant ces vingt ans, le bénéfice du recyclage s’en trouve tout simplement annulé [1] ! Et qu’on ne pense pas qu’il s’agisse là d’une hypothèse d’école :
« L’acier est le matériau majeur le plus recyclé au monde. Pourtant, au rythme actuel du développement de sa production-consommation de 3,5 % par an au cours du XXe siècle, le taux de recyclage actuel au niveau mondial, de l’ordre de 62 %, ne fait gagner à l’humanité qu’environ 12 années contre la raréfaction de la ressource en fer. C’est-à-dire que la consommation de minerai cumulée au cours du temps sera, en 2012, celle qu’on aurait connue en 2000 sans aucun recyclage. Et, en 2062, celle de 2050, si l’on cessait désormais entièrement de recycler. Amener, à l’échelle mondiale, le taux de recyclage à un niveau de 90 % ne ferait gagner à l’humanité que huit années supplémentaires (soit 20 ans de décalage), en l’absence de ralentissement de la progression de la consommation d’acier. Ce n’est qu’au-dessous de 1 % de croissance annuelle de la consommation mondiale d’une matière première que l’effet positif du recyclage sur la ressource devient important » (François Grosse cité par Arnsperger et Bourg, 2016 : 112).
Toutes ces limites, indépassables, du recyclage sont systématiquement occultées, méconnues et déniées, par tous les discours qui vantent les vertus de ce dernier, qu’ils soient tenus par des capitalistes (industriels ou commerçants) ou des (ir)responsables politiques, cherchant à rassurer consommateurs et citoyens en leur présentant le recyclage comme la solution au double problème (insoluble) de la consommation productive croissante de matières premières non reproductibles et de l’entassement des déchets (non recyclables). Tout en faisant reposer sur eux la responsabilité, via le tri des ordures ménagères, de la réussite d’une opération que conditionnent bien plus sûrement les choix effectués en amont, par les producteurs (capitalistes), des matériaux constituant leurs produits et leur emballage, tout comme d’ailleurs en aval l’existence ou non de filières industrielles de recyclage aussi efficaces que possible.
Il faut enfin dénoncer les effets pervers du recyclage lui-même. D’une part, dès lors que le déchet est érigé en ressource, qu’il devient valorisable au sens capitaliste du terme et qu’il est transformé du coup en matière première de nouvelles branches du capital industriel et du capital commercial [2], ces derniers requièrent inévitablement, au fur et à mesure où s’opèrent dans ces branches la concentration et la centralisation de ces capitaux, la production d’une masse toujours croissante… de déchets ! Et cette masse croissante de déchets requiert elle-même en amont une quantité croissante de produits recyclables, finissant sous forme de déchets. Par exemple :
« Tout comme leurs anciens ancêtres contremaîtres des chiffonniers, les principaux groupes industriels iraient contre la réussite de leurs entreprises en encourageant la réduction de ces flux détritiques. Dès lors, en rationalisant et systématisant cette “récup’” moderne, ne nous engageons-nous pas dans un itinéraire imposé ? Si les déchets deviennent demain nos principales ressources, ne sommes-nous pas tout simplement contraints de jeter pour continuer à produire ? » (Monsaingeon, 2017 : 107).
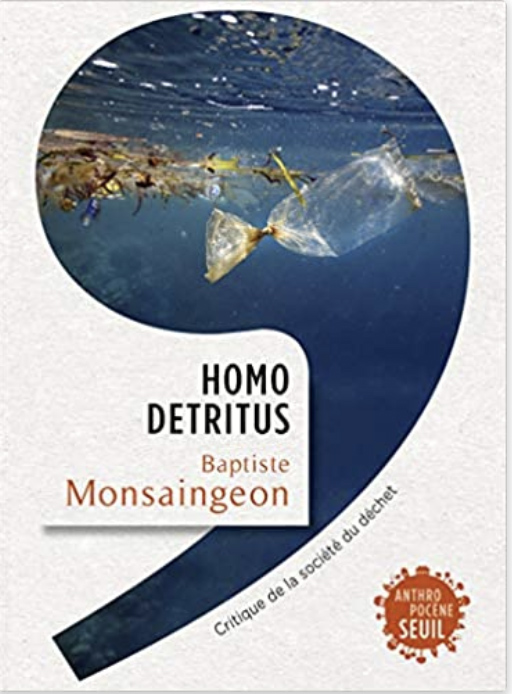
Ainsi, loin d’opérer comme des freins limitant l’échelle et le rythme de la consommation productive et improductive de matières premières et d’énergie, l’industrie et le commerce capitalistes du recyclage opèrent-ils au contraire comme des accélérateurs de l’une et de l’autre. Autrement dit, tout comme n’importe quelle branche de la production capitaliste, elle procède de l’hubris qui est la marque propre de cette dernière. Tandis que, d’autre part, les mêmes effets pervers se produisent du côté de la consommation improductive : en triant ses déchets, en alimentant l’industrie et le commerce capitalistes de ces derniers, le consommateur lambda peut se persuader, en toute bonne (in)conscience, de continuer à consommer autant et aussi mal tout en contribuant à sauver la planète : « bien jeter est devenu un moyen pour pouvoir continuer à (mieux) consommer (…) Le bien jeter est une modalité de cet oubli plus qu’un mode de résolution d’un problème en cours : un rituel contemporain de dénégation » (Id. : 113 et 118).
Le recyclage sert ainsi essentiellement de moyen, d’alibi et de paravent de la poursuite de « la croissance ». Loin de limiter et encore moins de faire cesser le pillage et le gaspillage des ressources naturelles, il permet de les poursuivre et de les amplifier en les « verdissant ». Conséquences :
« L’extraction [des ressources naturelles] se développe à un rythme deux à trois fois plus rapide que le recyclage, alertent les auteurs du Circulating Gap Report, un rapport annuel sur la progression de l’économie circulaire dans le monde et ses obstacles. Ils évoquent une “linéarité qui s’auto-entretient” liée au manque de solutions pour la fin de vie des produits, qui relève aussi d’une mauvaise conception initiale » (Berlingen, 2020 : 78)
Concluons. Se situant dans le cadre des rapports capitalistes de production, les différentes pratiques et techniques de « l’économie circulaire » ne peuvent ni d’ailleurs ne veulent se proposer de mettre fin à la nécessité d’une reproduction élargie du capital et par conséquent à l’élargissement inévitable de son empreinte écologique. Elles peuvent tout au plus réduire l’échelle et ralentir le rythme de la seconde relativement à ceux de la première.
C’est à une conclusion identique que parviennent Christian Arnsperger et Dominique Bourg. Défendant une conception radicale de « l’économie circulaire » impliquant une réduction drastique de l’échelle du procès social de production, soit l’instauration d’une économie stationnaire ou quasiment stationnaire, de fait incompatible avec le maintien des rapports capitalistes de production (ce dont eux-mêmes n’ont cependant aucune conscience, semble-t-il), ils en viennent à dénoncer les conceptions de « l’économie circulaire » qui se limitent à réduire l’empreinte écologique des capitaux singuliers sans se préoccuper de celle du capital social dans son ensemble. C’est que « des performances accrues de circularité au niveau micro et/ou meso peuvent aller de pair avec une détérioration des performances macro en termes de flux nets de matière » (Arnsperger et Bourg, 2016 : 96). Par exemple :
« Une entreprise ou un secteur peut parfaitement faire d’immenses progrès en termes de circularité (par exemple en rendant ses produits davantage recyclables par unité d’input et/ou d’output) sans que l’économie dans son ensemble devienne plus circulaire. Au contraire, des effets pervers bien connus, dits “effets rebonds” [3] , peuvent transformer une meilleure circularité “micro” en une moins bonne circularité “méso” et “macro” (…) des performances accrues de circularité au niveau micro peuvent aller de pair avec une détérioration des performances macro en termes d’énergie nette – notamment si les technologies de circularisation sectorielles requièrent une plus forte consommation de ressources dans d’autres secteurs pourvoyeurs de ces technologies ou de certaines composantes de ces dernières » (Id. : 105-106).
Si bien qu’en définitive, « vouloir mesurer la circularité d’une économie sans se préoccuper du degré auquel cette économie continue de croître est un contresens grave » (Id. : 100).
Sur la sobriété matérielle et l’efficacité énergétique
Examinons enfin ce qu’il en est des gains en matière de sobriété matérielle tout comme d’efficacité énergétique au sein du procès de production capitaliste. De tels gains sont avérés et d’ailleurs constamment renouvelés. Ils procèdent essentiellement de la mise au point de procédés permettant de limiter les pertes (rejets et déchets de matières premières, dissipation de l’énergie sous forme de chaleur ou reconversion de cette dernière) qui surviennent lors de tout procès de production, autrement dit de transformation de la matière et de l’énergie.
Cependant la limitation de pareilles pertes rencontre elle-même des limites physiques indépassables. Sans même se référer à ce que nous enseigne le second principe de la thermodynamique, relevons par exemple que, si le passage des ampoules à incandescence aux ampoules fluo-compactes ou à LED a permis de multiplier par dix l’efficacité énergétique (en passant de 15 à 150 lumens par watt consommé), il existe une limite de 200 lumens par watt au-delà de laquelle il n’est plus possible de produire de la lumière blanche (Cassoret, 2020 : 139). Et, plus on progresse dans la réduction de la consommation productive de ressources naturelles par unité produite, plus de nouveaux progrès sont difficiles à obtenir, en entraînant eux-mêmes un surcroît de consommation productive de matière et d’énergie.
Surtout, là encore, il se produit d’inévitables effets rebonds, inévitables parce que liés à la nécessité d’élargissement constant de l’échelle de la reproduction immédiate du capital : toute diminution relative de la consommation productive de ressources naturelles (matières premières ou énergie), par exemple par heure de travail, par unité de PIB ou par habitant, se traduit finalement par une augmentation absolue de celle-ci. En diminuant les coûts de production, les gains réalisés en matière de sobriété matérielle ou d’efficacité énergétique ont pour principal effet d’accroître la demande, partant la consommation productive de ressources naturelles, réduisant par conséquent les bénéfices de ces gains jusqu’à pouvoir les annuler et même finalement jusqu’à augmenter la consommation globale de ces ressources. Quelques exemples parmi de nombreux autres possibles :
. Entre 1975 et 1996, l’efficacité énergétique, mesurée par le rapport du PIB à la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émise pour le produire, a augmenté de 30 % aux Pays-Bas, de 34 % aux Etats-Unis, de 50,2 % en Autriche et de 64 % au Japon, ce qui n’a empêché la quantité totale de leurs émissions de CO2 d’augmenter respectivement de 24,3 %, de 29,7 %, de 11,6 % et de 25,9 %, les émissions par tête s’accroissant pour leur part respectivement de 9,1 %, 5,9 %, 4,9 % et 12 % (Foster, Clark et York, 2010 : 142). Tout simplement parce que le taux de croissance (le taux d’accumulation : le taux d’accroissement de son échelle et le taux d’accélération de son rythme) a été bien supérieur au taux de réduction de la consommation des combustibles fossiles par point de croissance ou par habitant. Si bien que l’efficacité énergétique croissante des formations capitalistes les plus développées (une moindre empreinte écologique par unité de richesse produite) est allée de pair avec une empreinte écologique globale accrue de ces mêmes formations, que ce soit au niveau global ou à celui de chacun de leurs membres.
. Aux Etats-Unis, entre 1980 et 2010, l’efficacité énergétique des véhicules automobiles (mesurée par la distance parcourue par quantité de carburant consommé) a été augmentée de 30 % (Foster, Clark et York, 2010 : 178), grâce à des moteurs moins gourmands, des véhicules plus aérodynamiques, une diminution des frottements au sol, etc. Mais cela n’a en rien fait diminuer la quantité totale de carburant consommé du fait de l’augmentation du nombre des véhicules, de leur usage plus intensif (un exemple type d’effet rebond), de l’augmentation de leur poids (due à leur taille, à leurs équipements de plus en plus nombreux) et de leurs performances (capacité d’accélération, vitesse de pointe, etc.), qu’il s’agisse des véhicules personnels avec la mise en circulation des monospaces et des SUV (sport utility vehicle )[4] ou des poids lourds. On voit clairement sur cet exemple que des innovations techniques sont incapables par elles-mêmes et à elles seules de garantir une moindre empreinte écologique, en termes de prélèvements de ressources naturelles ou de rejets de déchets.
. Aux Etats-Unis toujours, entre 1975 et 2010, la consommation moyenne par mile des avions a été réduite de 40 % mais la consommation totale de carburants de l’aviation civile à augmenter de 150 % (Foster, Clark et York, 2010 : 178). Même tendance en France : entre 2000 et 2019, alors que les émissions de CO2 par passagers-équivalents-kilomètres-transportés ont diminué de 112,2 g à 83,5 g, soit une réduction de plus d’un quart, la quantité totale de CO2 émise par le trafic aérien a augmenté de 20,3 à 23,7 millions de tonnes (+ 16,7 %) [5] .
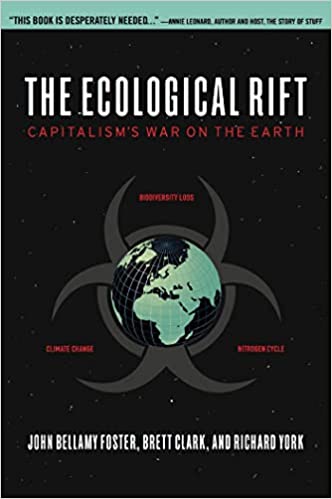
D’ailleurs, en dépit des gains d’efficacité énergétique, des chocs pétroliers des années 1970 et de la dépression consécutive à la crise financière de 2007-2009, la consommation d’énergie primaire mondiale n’a cessé de croître régulièrement, en passant de quelque quatre à quelque quatorze milliards de tonne équivalent pétrole entre 1965 et 2019. Si cette consommation a eu tendance à diminuer légèrement en France, tout comme dans d’autres formations centrales, à partir du milieu des années 2000, c’est à la faveur de la délocalisation des activités industrielles les plus gourmandes en énergie dans des formations périphériques et semi-périphériques, telles la Chine et l’Inde, où elle croît au contraire de manière exponentielle. C’est ainsi de l’équivalent de la consommation française que la consommation d’électricité mondiale croît toutes les années (Cassoret, 2020 : 19-21).
De même, selon un rapport du Panel international pour la gestion durable des ressources hébergé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement publié en 2016, on a assisté à un triplement des quantités de matières premières extraites de la planète Terre au cours des quarante années précédentes [6]. Et, en dépit de tous les efforts visant à les réduire, elles devraient encore plus que doubler entre 2011 et 2060 selon en rapport de l’OCDE publié deux ans plus tard [7] .
S’impose dès lors une conclusion sans appel : « Un système économique dévolu aux profits, à l’accumulation et à l’expansion économique sans fin aura tendance à utiliser les gains d’efficacité ou les réductions de coûts pour élargir l’échelle globale de la production. L’innovation technologique sera donc fortement orientée vers ces mêmes objectifs expansifs » (Foster, Clark et York, 2010 : 179). En conséquence, il est parfaitement illusoire de penser que, dans un cadre capitaliste, il soit possible de promouvoir une tendance structurelle à l’économie globale dans l’usage des ressources naturelles et qu’une pareille tendance puisse être développée uniquement par des innovations techniques continues. De pareilles innovations techniques sont monnaie courante dans le procès immédiat de reproduction du capital ; et, quelle qu’ait pu être l’importance des gains obtenus par leur biais en matière de sobriété matérielle et d’efficacité énergétique par unité de produits (ou unité de valeur), ils n’ont jamais mis fin à la course à l’accumulation du capital et, partant, au (gas)pillage des ressources naturelles à grande échelle. Bien au contraire, ils en ont été les moyens mêmes, en leur servant de surcroît le plus souvent d’alibi.
En conclusion, pas plus que celles d’un « développement soutenable » ou d’une « croissance verte », la promesse « transition écologique » en cours ou à advenir n’est en mesure de fournir une solution à l’indépassable contradiction entre les exigences d’une reproduction sans cesse élargie du capital et la finitude du cadre écologique dans lequel elle est censée se développer. Comme les précédentes, elle apparaît comme une imposture qui masque la perpétuation du caractère écocidaire de la dynamique capitaliste tout en lui ouvrant de nouveaux champs et en lui fournissant de nouveaux moyens.
Par Alain Bihr
Tiré de A l’Encontre
19 mai 2023
Pour lire la 1ère partie
Pour lire la 2e partie
Notes
[1] Au terme de vingt ans de croissance au rythme de 3 % par an, la quantité de matériau à remplacer sera en gros 1,8 fois plus importante (1,0320 = 1,80611) que la quantité initiale et les 80 % de cette dernière issus du recyclage devront être complétés par un prélèvement de même quantité que celui opéré vingt ans auparavant. [2] Les déchets représentent aujourd’hui un marché mondial de l’ordre de 300 milliards d’euros, dont la moitié est constituée par la valorisation des seuls déchets ménagers, qui ne représentent pourtant de 4 % de la masse globale des déchets (Monsaingeon, 2017 : 106). [3] Un effet rebond se produit lorsque la réduction d’une limite apposée à la consommation d’un produit déterminé conduit à l’augmentation de cette dernière. Ainsi des économies de matières premières et d’énergie par unités produites, qui vont se traduire par la réduction du prix de ces dernières, peuvent provoquer une augmentation de leur demande globale et, partant, celle de la consommation productive de matières premières et d’énergie pour la fabrication de ce bien ou service. La réduction au niveau micro s’accompagne d’une augmentation au niveau macro. [4] Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie, les SUV consomment en moyenne 25 % de plus de carburant qu’une automobile de taille moyenne : https://www.connaissancedesenergies.org/afp/transports-les-4×4-urbains-source-majeure-daugmentation-des-emissions-mondiales-de-co2-selon-laie-191016 [5] Direction générale de l’aviation civile, Les émissions gazeuses liées au trafic aérien en France en 2020, Paris, 2021, page 6. [6] United Nations Environment Program, Global Material Flows and Resource Productivity. An Assessment Study of the UNEP International Resource Panel, Paris, 2016, page 30. [7] OCDE, OECD Highlights. Global Material Resources Outlook to 2060 – Economics Drivers and Environmental Consequences, Paris, 2018, page 4.Bibliographie
Arnsperger Christian et Bourg Dominique (2016), « Vers une économie authentiquement circulaire », Revue de l’OFCE, n°145.
Aurez Vincent et Georgeault Laurent (2016), Économie circulaire. Système économique et finitude des ressources, Louvain-la Neuve, De Boeck Supérieur.
Benady Anne et Ross-Carré Hervé (2021), L’économie circulaire, La Plaine Saint-Denis, Afnor Éditions.
Berlingen Flore (2020), Recyclage : le grand enfumage. Comment l’économie circulaire est devenue l’alibi du jetable, Paris, Rue de l’Echiquier.
Cassoret Bertrand (2020), Transition énergétique. Ces vérités qui dérangent !, Louvain-la-Neuve, Paris, De Boeck Supérieur.
Écoinfo (2012), Impacts écologiques des TIC. Les faces cachées de l’immatérialité, Les Ulis, EDP Sciences.
Foster John Bellamy, Clark Brett et York Richard (2010), The Ecological Rift : Capitalism’s War on the Earth, New York, Monthly Review Press.
Frenoux Emmanuelle (2019), « Quel impact environnemental pour l’informatique ? », EcoInfo, Paris, CNRS, Limsi, Polytech Paris-Sud.
Lévy Maurice et Jouyet Jean-Pierre (2006), L’économie de l’immatériel : la croissance de demain. Rapport de la commission sur l’économie de l’immatériel au Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Paris, La Documentation française.
Monsaingeon Baptiste (2017), Homo detritus. Critique de la société du déchet, Paris, Éditions du Seuil.
Tanuro Daniel (2012), L’impossible capitalisme vert, Paris, La Découverte.
Source : https://www.pressegauche.org/La-transition-ecologique-imposture-et-nouvelle-frontiere-du-capital-III

