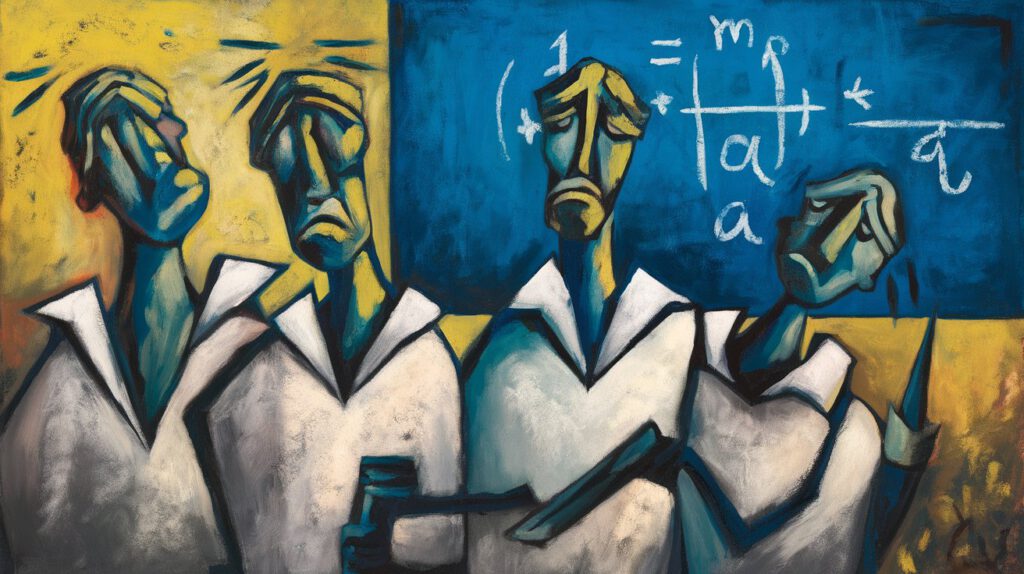Note d'analyse – Philippe Defeyt – Version 21 janvier 2025
NB : Il s’agit ici de premières réflexions qui visent plus à susciter un débat qu’à le conclure. Rien de définitif donc dans les réflexions qui suivent. Par ailleurs, j’avoue ne pas connaître toutes les subtilités réglementaires d’un monde surréglementé… La note se concentre sur l’enseignement secondaire. Je remercie ceux et celles qui ont réagi à une première version ; je reste évidemment seul responsable du contenu de cette note.
Introduction
Le projet d’arrêter les nominations définitives dans l’enseignement obligatoire est incontestablement une des mesures fortes de la DPC 2024-2029. Voici l’extrait dont question : « l’engagement des nouveaux enseignants (se fera) sous la forme d’un contrat à durée indéterminée avec une augmentation de l’ordre de deux heures hebdomadaires (avec assouplissement possible en début et en fin de carrière), et ce afin de mettre fin progressivement au régime statutaire » (p.14)
Traduction concrète : fin des nominations définitives et accès accéléré (immédiat ?) à un CDI pour les nouveaux enseignants, CDI supposé les rassurer quant à leur avenir professionnel. Objectif (officiellement) poursuivi : renforcer l’attractivité pour les jeunes enseignants et les retenir en début de carrière.
Un problème d’équité, et donc éminemment politique, se pose d’emblée : pourquoi changer les règles pour (certains) enseignants et les travailleurs des administrations publiques mais pas pour
d’autres catégories de “fonctionnaires” ? On peut pourtant penser qu’il y a aussi des problèmes de pénuries dans l’administration, en tout cas pour certains métiers/certaines fonctions…
Garder le statut actuel pour certains (ex : les policiers, les magistrats) et pas pour d’autres (ex : les enseignants du niveau obligatoire) serait une politique de deux poids, deux mesures. Peut-on à la fois affirmer que l’enseignement est « la mère de toutes les batailles » et demain accorder aux enseignants des pensions plus faibles, à revenu égal, que celles des policiers (ce qui resterait plus que probablement le cas même si un second pilier était mis en place en faveur des enseignants).
On peut aussi se poser des questions sur le timing de cette proposition, dans un contexte où le consensus large qui existait autour du Pacte d’excellence est pour le moins affaibli et que sa mise en œuvre suscite déjà des tensions.
Dans cette perspective, la note qui suit vise à explorer divers éléments de contexte quant à cette volonté politique. Elle comprend cinq sections et se termine par quelques conclusions.
- Les caractéristiques principales du statut : discussion
- Le contexte démographique
- Le début de carrière
- Degré d’autonomie des écoles : faire des choix
- Brève notice budgétaire
Cette note ne fait évidemment pas le tour de la question. C’est ainsi que, notamment, ne sont pas abordés les deux points suivants :
- l’idée avancée par certains d’augmenter les salaires pour les profils en (forte) pénurie
- l’examen de ce que d’aucuns appellent des abus liés au statut ; il y en a probablement, mais leur importance ne me semble pas documentée (je n’ai rien trouvé en tout cas).
- Les caractéristiques principales du statut : discussion
Au même titre que le statut des fonctionnaires, le statut des enseignants a quatre grandes caractéristiques a priori positives : une plus grande stabilité dans l’emploi en cas de tensions avec la direction (encore que des modifications visant à l’éroder quelque peu ont été prises ces dernières années, y compris dans l’enseignement), une garantie de garder son emploi/revenu même sans charge horaire, une meilleure pension (pour faire simple : un taux de remplacement de 75%, plutôt que de 60%, péréquation automatique) et une indemnisation à 100% des périodes de maladie, en tout cas pour un certain temps.
Discussion
- Certains ajoutent une dimension symbolique à la nomination : la reconnaissance professionnelle. ; mais celle-ci s’explique d’abord parce qu’il y a des statutaires et des non- statutaires (la nomination est donc un atout positionnel) plus que pour des raisons intrinsèques (il y a d’autres moyens pour remercier/valoriser un travailleur, y compris sur le plan matériel).
- Les quatre dimensions principales sont actuellement liées mais pourraient très bien, demain, être dissociées : on peut, par exemple, garder le statut dans sa dimension “protection” mais modifier les paramètres des revenus des retraites et/ou des périodes de D’où la proposition défendue par certains d’un CDI adapté à l’enseignement, qui intégrerait les règles générales d’un CDI mais avec des “avantages” – par exemple en matière de maladie et/ou de fin de carrière et/ou de protection – spécifiques aux enseignants. En effet, un CDI classique n’offre pas de garantie de garder son emploi (en fait d’être rémunéré) s’il n’y a plus de charge horaire (ou en cas de charge horaire incomplète).
- La stabilité de l’emploi n’évite pas les risques de frottements, voire de conflits, entre un PO et ses enseignants sur les choix pédagogiques. Ce type de problème ne peut être ramené aux éventuelles difficultés qui concernent tous les travailleurs, enseignants compris, comme le non respect des horaires, des comportements inappropriés, des absences injustifiées… Si une protection spécifique doit être instaurée il faut bien baliser les types de conflits employeur/employé qui seraient concernés. On notera à cet égard que la législature précédente a vu des évolutions en matière d’évaluation ; la procédure est longue avant une éventuelle fin de parcours – provisoire ou définitive – mais elle est très clairement balisée.
- Ces nouvelles règles ne concerneraient – à vérifier le moment venu – que l’enseignement Or, contrairement au point de vue du gouvernement de la Fédération, les problèmes posés aux enseignants dans les Hautes Écoles en début de carrière (peu de stabilité, exercice du métier dans plus d’une institution, etc.) sont globalement les mêmes que dans l’enseignement obligatoire.
- Il n’y a pas non plus de raisons d’exclure a priori les universités de ce type de réflexions.
- Le contexte démographique
La réforme annoncée va trouver place dans un contexte de baisse généralisée des effectifs scolaires dans l’enseignement obligatoire.
Or, toutes autres choses égales par ailleurs, toute diminution de la population scolaire réduit d’autant la possibilité de proposer des CDI (avec des mécanismes plus ou moins “généreux” de maintien à l’emploi) et/ou des nominations sans coût budgétaire. Ce coût budgétaire est déterminé par le nombre d’enseignants qui continueraient à être payés sans donner cours.
Mener cette réflexion est d’autant plus important que les contours de la garantie d’emploi apportée par la réforme prévue ne sont pas encore clairs. Sans éventuelles spécificités, un CDI dans l’enseignement n’apporte pas la même garantie qu’une nomination classique.
Attention, les impacts des reculs démographiques annoncés sur l’emploi dans l’enseignement ne sont ni linéaires ni proportionnels. En effet, le capital-périodes dans l’enseignement primaire ordinaire et le NTTP (nombre total de périodes professeurs) dans l’enseignement secondaire ordinaire sont calculés sur base de divers paramètres, avec des seuils et avec retard. Illustrations :
- Par exemple, « Le nombre de périodes-professeurs pour la formation commune au 1er degré commun est obtenu en multipliant le nombre total d’élèves de ce degré par 20, et en divisant ce produit par 16 pour une première tranche de 40 élèves, par 18 pour une deuxième tranche de 40 élèves, par 22 pour une troisième tranche de 40 élèves, et par 24 pour les élèves suivants. » (Circulaire1112)
- Autre illustration : « Dans chaque catégorie de comptage (à l’exception des 7èmes années) le nombre de périodes professeurs obtenu par le calcul sera éventuellement augmenté, de manière à atteindre un minimum déterminé. » (Circulaire 113)
- C’est cette non linéarité qui explique l’allure des courbes des deux graphiques de la page suivante ; les données proviennent de la très intéressante étude « MaSala : Simulateur de la masse salariale dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles: Méthodologie, perspectives et scénarios »2. On peut donc supposer qu’avec de tels mouvements de la population scolaire les départs naturels permettraient d’absorber une augmentation – en tout état de cause progressive – du nombre d’enseignants avec une stabilité d’emploi.
- L’effet retard est ici précisé : « La population scolaire à prendre en considération pour le calcul du NTPP relatif à une année scolaire donnée est constituée exclusivement du nombre d’élèves régulièrement inscrits le 15 janvier à 16 h de l’année scolaire précédente. » (Circulaire 114)
Notons trois points encore :
- Les diminutions des populations concernées par chaque niveau d’enseignement (voir graphique en bas de la page suivante) vont se prolonger au cours de la prochaine législature, très nettement pour le secondaire et avec une stabilisation à partir de 2031 pour le primaire, les deux baissant d’environ 10% entre 2023 et
- Les populations concernées par l’enseignement obligatoire n’évoluent pas, loin de là, au même rythme dans chacun des arrondissements comme le montre le tableau en haut de la 5. Les différences d’un arrondissement à l’autre, en absolu et en pourcentage, sont importantes. Cela va, pour le secondaire, de -4,8% dans l’arrondissement de Soignies à -15,9% dans celui d’Arlon. Or, toutes choses égales par ailleurs, il est a priori plus difficile de garantir un maintien à l’emploi là où la population concernée baisse plus.
1 Circulaire générale relative à l’organisation de l’enseignement secondaire ordinaire et à la sanction des études Année scolaire 2024-2025, n°9333, 2 août 2024
2 Discussion paper, Auteurs : Elodie Lecuivre, Jean-Marc Paul, Henri Bogaert, CERPE, octobre 2024
- Les structures démographiques des enseignants ne sont pas identiques d’un arrondissement à l’autre, voir ci-dessous, mais les différences sont relativement C’est ainsi que qu’entre 14,2% (Philippeville) et 20,1% (Namur) des enseignants auront d’une manière ou d’un autre quitté l’enseignement dans les 10 ans qui viennent.
L’impact, par arrondissement, sur l’emploi global ou sur des emplois individuels, dépend de nombreux facteurs (différence entre la population concernée et la population scolaire, pyramide des âges, taille des établissements, etc., etc., et de glissements dans les choix d’école, des populations scolaires entre écoles ou entre réseaux, etc., etc.) ; le mesurer, arrondissement par arrondissement, nécessiterait des études approfondies qui dépassent l’objet de cette note ; qui plus est, il faudra de toute manière, pour partie en tout cas, faire cet exercice sur base d’hypothèses, toutes les évolutions n’étant pas nécessairement modélisables.
Il y a en particulier la problématique d’enseignants qui, dans le cadre d’une baisse tendancielle de l’emploi, pourraient se retrouver sans heures de cours ou avec un horaire incomplet. A priori, on pourrait penser que les départs naturels sont peut-être suffisants pour éviter ce qu’il faut bien appeler des licenciements. Mais, au plus on descend dans la granularité (enseignants dans telle matière dans tel réseau dans tel arrondissement), la combinaison d’un recul de l’emploi (on a vu qu’il pouvait baisser plus fort dans certains arrondissements) et d’autres évolutions pourrait conduire à des licenciements. La question de savoir qui assumerait le coût d’éventuels licenciements est posée.
De manière paradoxale, si l’octroi d’un CDI aux jeunes enseignant atteint son objectif (= stabilisation de l’emploi), on diminue les sorties naturelles et augmente donc par là même – toutes autres choses égales par ailleurs – le risque de devoir licencier d’autres enseignants avec CDI. Le risque serait encore plus élevé si étaient mises en place des règles plus strictes pour la DPPR. Encore faut-il déterminer ce que deviendront les enseignants concernés si c’était le cas ; il n’est pas exclu que pour partie ils rejoindront la population des enseignants malades. A cet égard, il faudra aussi voir si les annonces récentes ne vont pas susciter une vague de départs en DPRR plus ou moins avancés.
La diminution des populations scolaires conduira à une baisse de la taille moyenne des établissements, ce qui rend plus compliqué encore le maintien à l’emploi ou le maintien dans un temps plein, surtout si on devait aller (voir section D) vers une plus grande autonomie des écoles dans le choix des équipes éducatives.
Au total, on peut néanmoins penser que, globalement et au niveau de chaque arrondissement, les départs à la pension ou autres départs naturels seront (largement) suffisants pour absorber la baisse annoncée des effectifs scolaires, même si, évidemment, on ne peut exclure des tensions dans certains établissements et/ou pour certaines matières.
Deux remarques pour terminer :
- on peut supposer que la baisse des besoins en enseignants, couplée à un effet positif de la mise en place d’un CDI en début de carrière si elle renforce effectivement l’attractivité, pourrait contribuer à réduire la pénurie et donc augmenter à due concurrence la masse salariale ;
- en tout état de cause, on doit s’attendre à un vieillissement du corps
- Le début de carrière
Le point central de la discussion, lié politiquement à celui de la fin des nominations, concerne le début de carrière, l’intention du gouvernement de la Fédération étant de proposer des CDI en début de carrière pour attirer et surtout garder de jeunes enseignants.
Actuellement, es jeunes enseignants sont en effet triplement pénalisés par:
- des CDD, de plus ou moins longue durée ; il s’agit soit d’un CDD prévoyant un horaire plus ou moins complet de X heures pour une année scolaire entière, soit d’un CDD temporaire de remplacement d’un enseignant dans ses fonctions, par exemple suite à un accident ou une maladie, soit encore une combinaison de ces deux types de CDD ;
- le plus souvent plusieurs affectations (avec les coûts – dépenses de déplacement et fatigue – qui y sont liés) ;
- des périodes de chômage pendant les congés d’été, voire à d’autres moments de l’année. Ces périodes d’instabilité/d’insécurité peuvent couvrir plusieurs années
Analyse
- A priori il n’y a pas d’opposition entre des CDI plutôt que des CDD en début de carrière et une nomination plus Beaucoup de fonctionnaires ou assimilés débutent par un contrat de remplacement (par exemple pour remplacer un.e collègue absent.e), puis obtiennent un CDI puis sont nommés en passant par une période de stage.
- Que l’on supprime ou non les nominations plus tard dans la carrière, la question est de savoir si, effectivement, on peut proposer des CDI dès le début de carrière sans coûts supplémentaires ou en tout cas à un coût globalement acceptable au vu de l’objectif Or des coûts supplémentaires il y aura, ne serait-ce que parce qu’il faudra assumer coût en salaires des actuelles périodes de chômage pendant les congés d’été ou en cours d’année.
- Si on veut contenir l’enveloppe supplémentaire de la réforme, il faudra satisfaire une condition essentielle mais difficile à rencontrer, en tout cas dans le fonctionnement actuel : saturer le temps de travail de manière acceptable en termes de conditions de travail (par exemple ne pas être obligé de compléter son horaire en devant se déplacer sur de très longues distances).
- Créer les conditions pour saturer un horaire (c’est-à-dire faire en sorte qu’un.e e enseignant.e désormais bénéficiaire d’un CDI travaille pour chaque heure prévue dans son contrat) passe notamment par la mise en place, la généralisation ou l’intensification de diverses modalités de fonctionnement au quotidien des établissements scolaires :
- organiser une fluidité très large entre écoles proches qu’elles appartiennent ou non au même réseau ;
- co-responsabiliser des PO (géographiquement) proches en leur permettant de fonctionner comme un groupement d’employeurs, en tenant compte bien sûr des spécificités du métier et du secteur ;
- favoriser une organisation qui permet, pour une matière et une classe donnée, d’activer plusieurs es en fonction des parties de matière qu’ils/elles préfèrent/maîtrisent mieux ;
- valider des compétences/matières que des enseignants pourraient exercer même s’ils ne sont pas à proprement parler dans leur champ d’action reconnu, cela impliquant une réforme des titres requis ; de manière générale, assouplir encore les règles sur les titres et fonctions ;
- élargir encore les possibilités de mobilité entre l’inférieur et le supérieur dans le secondaire, en tout cas pour les remplacements ;
- activer des remplacements pour des activités autres que les cours “classiques”, toujours dans l’idée de saturer le temps de travail ;
- de favoriser une souplesse d’organisation horaire dans l’établissement accueillant des remplaçants ; concrètement l’idée est ici de répartir temporairement, si nécessaire !, les prestations d’un enseignant sur plusieurs semaines – par exemple 15 heures une semaine et 25 la semaine d’après – pour permettre à un remplaçant temporaire de trouver plus facilement sa place le temps ; d’autres ajustements transitoires sont possibles ;
- organiser les horaires en “blocs” pour certains cours ; qui dit qu’un cours doit nécessairement durer pendant toute l’année scolaire ? ; qui dit que les horaires doivent se répéter à l’identique semaine après semaine ? ; plus de cours organisés avec des horaires plus concentrés permettraient de faciliter l’insertion de remplaçants ;
- intégrer dans le temps de travail les périodes qui seraient reconnues – en début de carrière – pour préparer des cours et autres activités de nature pédagogique ; le crédit total donné à un jeune enseignant (sous la forme d’une charge horaire allégée) pourrait être activé progressivement en fonction des autres charges ;
- développer et activer des méthodes de transmission de savoirs qui permettent, pour une partie des cours, de se passer, au moins en partie ou pour un temps, d’un enseignant/enseignement “classique” : cours à distance, tutoriels, accompagnement par des élèves plus âgés, appel plus large à des enseignants “experts”, ; l’activation de tels modalités fluidifieraient, de manière générale, l’occupation des élèves et, pour ce qui est des remplaçants, permettrait d’organiser plus facilement leur intervention ;
- accueillir dans ce qui serait un pool au service d’une communauté scolaire de jeunes enseignants désormais en CDI, de futurs enseignants encore aux études et d’enseignants pensionnés intéressés qui, à des conditions à définir, pourraient participer à la fluidité
du système ; l’arrondissement est peut-être le bon niveau pour organiser de tels pools, sauf peut-être dans les plus petits ; ; on pourrait ajouter à ces pools les enseignants en fin de carrière dont on aurait redéfini les tâches et activités dans une perspective de maintien à l’emploi ;
- valoriser dans le temps de travail le temps de déplacement répondant à certaines conditions ; à cet égard, il semble que les déplacements d’une implantation à l’autre devraient être considérés comme temps de travail consécutivement à l’arrêt de la Cour européenne du 10 septembre 2015.
- Ces pistes visent à une plus grande souplesse dans l’organisation du fonctionnement d’un établissement, à une plus grande responsabilisation solidaire par rapport aux collègues, à plus de respect pour les jeunes enseignants non encore stabilisés dans une école (difficultés, droits et obligations, doivent être équitablement partagés entre les insiders et les outsiders), , et donc, n’oublions quand même pas les principaux intéressés, de réduire le nombre d’heures non “occupées”.
- Notons que de telles manières de faire sont de facto déjà utilisées, en tout ou en partie, de manière plus ou moins intensive, dans de nombreuses écoles. Mais on peut, on doit, aller plus loin dans leur activation et généralisation. Mais, pour autant qu’elles soient pertinentes et techniquement possibles, ces pistes sont-elles acceptables ?
- Implicitement on considère que les entrants dans le système sont des Diverses évolutions, notamment les questionnements de personnes engagées dans des jobs jugés moins attractifs après quelques années, font qu’on peut supposer qu’il y aura de plus en plus de nouveaux enseignants plus âgés. Il serait pertinent, dans ce cas, de reconnaître des anciennetés plus attractives que celles reconnues par les règles habituelles en la matière.
- Une autre question essentielle : le temps de travail proposé dans le CDI serait-il négociable ? La volonté d’attirer et de garder de jeunes enseignants pencherait plutôt pour respecter la préférence du Mais sa préférence ne correspondra pas nécessairement à l’optimum dans l’organisation globale. En tout état de cause, au plus on irait – de commun accord – vers un CDI, au plus le système doit être responsabilisé pour saturer le temps de travail.
- Degré d’autonomie des écoles : faire des choix
Un débat récurrent, qui va qui vient, concerne le degré d’autonomie à accorder aux établissements, notamment en matière d’engagements. L’autonomie dans le domaine éducatif est une réalité à géométrie variable.
Une note de l’OCDE de 2011 dit ceci : « Dans le cadre de l’enquête PISA 2009, il a été demandé aux chefs d’établissement d’indiquer qui, du “chef d’établissement”, des “enseignants”, du “conseil de direction de l’établissement”, des “autorités régionales ou locales en charge de l’éducation” ou des “autorités nationales en charge de l’éducation”, assume une part importante des responsabilités dans les domaines suivants : choisir les enseignants à engager ; congédier les enseignants ; déterminer le salaire initial des enseignants ; déterminer les augmentations de salaire des enseignants ; établir le budget de l’établissement ; et décider de la ventilation du budget dans l’établissement. »
Cette même note de l’OCDE tend à relativiser l’impact de ces autonomies sur la performance globale du système scolaire. Pour une analyse critique des impacts d’une plus grande autonomie, voir aussi
« L’autonomie n’est pas une solution miracle » des Cahiers pédagogiques.
« Au niveau national, plus les établissements d’enseignement sont nombreux à détenir la responsabilité de la définition et de l’élaboration de leurs programmes et évaluations, plus la performance du système d’éducation dans son ensemble est élevée, même après contrôle du PIB. Les systèmes d’éducation qui accordent aux établissements une plus grande marge de manœuvre dans les décisions portant sur les systèmes d’évaluation des élèves, les cours proposés, le contenu de ces cours et les manuels utilisés, sont aussi ceux qui font état des meilleurs résultats en compréhension de l’écrit. Cette corrélation s’observe même si, au niveau individuel des établissements, la responsabilité dans la définition des programmes n’est pas forcément associée à de meilleurs résultats.
Par contraste, il n’existe pas de relation évidente entre l’autonomie dans l’affectation des ressources et la performance au niveau national, notamment parce que la répartition des ressources a tendance à bénéficier individuellement aux établissements, sans nécessairement influer sur les performances du système d’éducation dans son ensemble. »
Directement, l’autonomie en matière de choix des enseignants ne semble donc pas avoir un impact important sur l’efficacité du système d’enseignement. Mais elle peut permettre de faire vivre d’autres dimensions d’une plus grande autonomie.
Ce bref rappel n’a pas pour volonté de trancher cette question. Mais, si on devait aller vers plus d’autonomie pour les engagements, ce qui pourrait convenir à la coalition azur, il est clair que cela augmente – toutes choses égales par ailleurs – la difficulté de garantir une stabilité d’emploi individuelle dans le cadre d’un CDI normal ; dans le cadre d’un CDI adapté ou du maintien des nominations classiques, un telle volonté risquerait d’augmenter les dépenses budgétaires (enseignants payés mais sans donner cours).
En effet, en cas de recul de la population scolaire il est possible qu’on doive réduire le volume d’heures voire se passer d’un enseignant, même plus âgé (sans que ses qualités propres soient concernées). Avec un CDI classique, il se retrouverait sans emploi ni revenus (hormis le chômage bien sûr). Si l’enseignant est de qualité, il pourrait certes rejoindre une autre école, pour autant qu’il soit choisi par son PO, devenu autonome en la matière… A tout le moins pourrait-on prévoir que le passage entre deux établissements s’accompagne du maintien de l’ancienneté.
En tout état de cause, au plus un établissement du secondaire est petit, au plus il est compliqué d’assurer à tou.tes un temps plein (pour ceux/celles qui le souhaitent évidemment). On pourrait donc imaginer que l’octroi d’une plus grande autonomie s’accompagne de l’obligation d’associer au moins deux PO pour co-gérer les ressources humaines, ce qui nous ramène à la section précédente.
- Brève notice budgétaire
La politique proposée par le gouvernement de la Fédération va, toutes choses égales par ailleurs, coûter plus cher :
- d’abord parce que les cotisations patronales sont plus élevées pour les CDI que pour les statutaires ; à cet égard on peut supposer que l’écart actuel est en tout état de cause appelé à diminuer au vu des contraintes budgétaires du gouvernement fédéral ; précisons aussi que le coût d’environ 500 millions avancé par le PS (montant non vérifié par mes soins) est un coût global estimé en faisant l’hypothèse que la masse salariale reste celle d’aujourd’hui (or elle est appelée à diminuer) et qu’il n’y a plus aucun statutaire, ce qui n’est pas pour tout de .. ; par ailleurs, au vu des difficultés budgétaires du fédéral, on peut supposer que son gouvernement décidera d’augmenter la cotisation de responsabilisation, limitant dès lors à due concurrence les écarts de coûts pour la Fédération entre les statuts ;
- parce qu’elle est supposée limiter les pénuries et donc augmenter, toutes choses égales par ailleurs, la masse salariale (NB : les volumes de l’emploi évoqués dans la section consacrée aux évolutions démographiques concernent les enseignant effectivement sur le terrain) ;
- parce que les CDI couvriront, peut-on supposer, des périodes aujourd’hui non payées par la Fédération (congés scolaires et périodes sans affectation pendant l’année scolaire) ;
- parce qu’il est probable qu’il ne sera pas possible de saturer entièrement le temps des jeunes enseignants en CDI ;
- parce des surcoûts sont possibles si les CDI devaient bénéficier de périodes de revenu garanti qui sont aujourd’hui réservées aux
Il y a par contre des économies possibles résultant de ce que les périodes de maladie des CDI ne sont pas à charge de la Fédération mais surtout parce que les nouveaux contrats augmenteraient le temps de travail.
Attention encore : ces calculs doivent être adaptés si les salaires horaires étaient augmentés pour attirer des enseignants.
* * *
Que tirer de tout ceci, après avoir rappelé qu’il s’agit de réflexions exploratoires ?
- Un problème d’équité se pose d’emblée : pourquoi changer les règles pour (certains) enseignants et les fonctionnaires des administrations et pas pour d’autres catégories de “fonctionnaires” ?
- On peut aussi se poser des questions sur le timing de cette proposition, dans un contexte où le consensus large qui existait autour du Pacte d’excellence est pour le moins affaibli et que sa mise en œuvre suscite déjà des
- Le débat gagnerait en clarté et en pertinence si on distinguait les différentes dimensions de la nomination.
- Les contours de la forme de stabilité d’emploi qui serait garantie dans un CDI adapté (déjà baptisé CDIE) doivent être mieux définis. C’est probablement le nœud du débat. De cette définition dépend notamment une plus juste estimation du coût de la politique voulue par le
- Les évolutions démographiques des populations scolaires et du corps enseignant sont telles qu’elles ne semblent pas rendre plus compliquée la mise en œuvre d’une garantie d’emploi Mais, au plus on descend dans la granularité (enseignants dans telle matière dans tel réseau dans tel arrondissement), la combinaison d’un recul de l’emploi (on a vu qu’il pouvait baisser plus fort dans certains arrondissements) et d’autres évolutions pourrait conduire à des licenciements.
- Promettre un CDI et, implicitement en tout cas, une stabilité d’emploi personnelle à tous les enseignants pose trois défis majeurs :
- la charge salariale globale est, toutes autres choses égales par ailleurs, appelée à augmenter progressivement si on remplace le statut par un CDI généralisé ;
- si on veut contenir le coût d’une telle mesure (il y aura de toute manière un sur-coût salarial pour les périodes de congé et, le cas échéant, les périodes sans charge horaire actuellement chômées), il faut saturer le temps de travail des jeunes enseignants, autrement dit éviter qu’ils soient payés dans le cadre de leur CDI sans qu’ils soient effectivement occupés ; rencontrer cette contrainte passe par des modifications en profondeur de l’organisation du système scolaire ; elles sont tellement importantes qu’on peut se poser la question de leur réalisme politique et syndical ; mais notons que ces transformations sont de toute manière nécessaires pour rencontrer des attentes pédagogiques et éviter trop d’heures de cours non données ;
- garantir une stabilité d’emploi personnelle serait encore plus difficile à concrétiser si on donnait plus d’autonomie aux écoles dans le choix des
- L’analyse montre qu’il est difficile de mener ce débat isolément d’autres Organisation de l’école au quotidien, politique salariale, évolution du régime des DPPR, statut, baisse des populations scolaires, contrainte budgétaire, modalités pour les fins de carrière, degré d’autonomie des établissements pour le choix des enseignants, etc., etc., forment un tout. Aussi est-ce, peut-être, l’occasion de reconstruire un consensus sociétal, associant les enseignants, autour de l’école. Il est donc d’autant plus dommage d’avoir lancé la mesure CDI en pâture à l’opinion publique sans l’avoir, au préalable, étudiée rigoureusement et dans sa globalité.
Philippe Defeyt
Sources : Bureau fédéral du Plan et CERPE – Calculs propres
PDF téléchargeable de l’article incluant les graphiques et tableaux
Pour lire sur POUR les autres articles de Philippe Defeyt, mettre les mots “Philippe Defeyt” dans la zone de recherche en haut à droite.